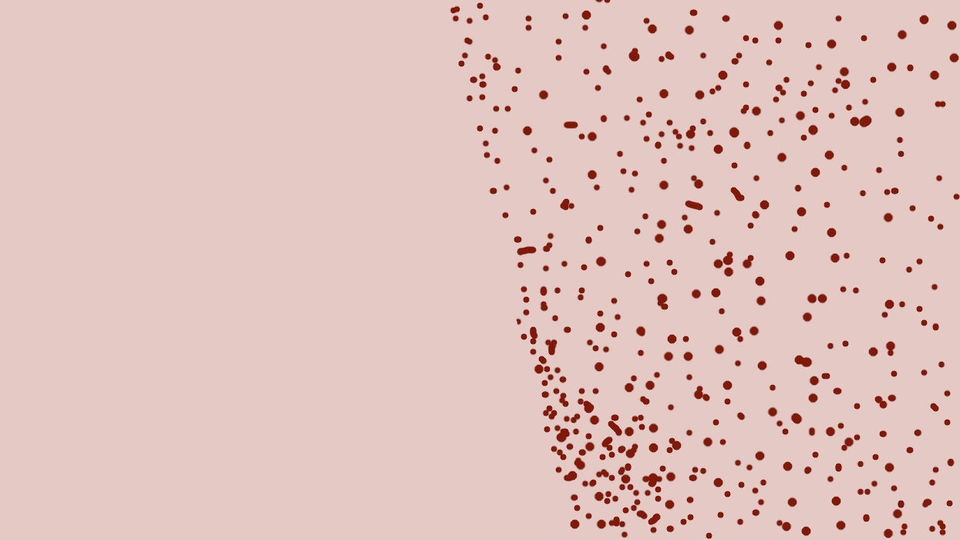A qui profite la notion d’empreinte carbone individuelle ?
Un matin de novembre, période de l’horreur consumériste absolue du Black Friday, je trainais sur Facebook quand je suis tombée sur un article qui m’a fait l’effet d’une petite bombe atomique intellectuelle : “Oubliez votre empreinte carbone, parlons de votre ombre carbone”, d’Emma Pattee, sur le média en ligne MIC. L’article est en anglais, et il contient selon moi une idée centrale pour arrêter le bullshit de l’écologie bourgeoise des petits gestes : et si l’indicateur de “l’empreinte carbone”, qui permet de quantifier l’utilisation de carbone émise par une personne, une activité ou une organisation, ne faisait paradoxalement qu’empirer notre rapport à l’écologie ?
L’empreinte carbone, un outil de quantification… individuelle
Reprenons très calmement l’historique de cette formidable idée qu’est l’empreinte carbone. Dès 1997, différents pays du monde se mettent d’accord, sur le principe, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est le protocole de Kyoto, signé en 1997 donc, qui entre en vigueur en 2005 dans les Etats signataires. Cet accord-cadre international oblige les pays à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane et quatre autres gaz dont on vous épargne les noms à rallonge), ce qui permet ensuite de calculer l’équivalent en CO2, c’est-à-dire la fameuse “empreinte carbone”, ou “impact carbone” (carbon footprint en anglais). Cet indicateur devient un outil essentiel de la quantification de l’impact humain sur le dérèglement climatique.
Pour démocratiser l’idée que toute activité humaine a un équivalent en émission de CO2 (une empreinte carbone donc, si vous suivez toujours) et un impact sur le climat, émerge une méthode de calcul scientifique pour permettre aux entreprises de quantifier leur émissions : c’est l’outil du Bilan carbone. Il se développe en France dans les années 2000 grâce aux travaux du scientifique français Jean-Marc Jancovici et de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Cet outil de diagnostic est, selon l’un des responsables de l’Association Bilan Carbone, l’un des seuls existants lors de son développement dans les années 2000, avec un outil américain (le GreenHouse Gas Protocol).
On aurait pu s’arrêter là et culpabiliser à outrance les multinationales dont l’empreinte carbone est équivalente à celle de plusieurs pays en voie de développement. Mais se sont développées ensuite des versions individuelles de cette comptabilité, comme le Bilan carbone personnel. Elles calculent vos émissions carbone en fonction de votre mode de vie (habitat, moyens de transport, nombre de personnes dans le foyer, régime alimentaire…) et des produits que vous possédez et consommez. Essayez, c’est vertigineux.
J’ai beau avoir arrêté la viande et recycler mes vêtements, j’habite toujours dans un appartement parisien construit dans du gruyère qui chauffe et isole très mal, et je consomme des produits laitiers. Il y a d’énormes failles dans notre mode de vie occidental, qui est un problème structurel, que l’on rattrape volontiers par les fameux “petits gestes” dont nous parlions, ceux qui donnent bonne conscience. Ça fait toujours du bien de nous dire que le carton protégeant notre nouveau téléphone, arrivé de Chine en 24h, ira dans la poubelle recyclable.
Mais si j’ai tendance à pâlir quand je vois d’énormes promos sur les jeans Asos dans mes pubs Instagram, suis-je pour autant seule responsable de mon achat compulsif et donc de mon empreinte carbone ? Qui émet en premier lieu, l’individu, par sa consommation, ou les entreprises par la production de biens et services émetteurs ? La responsabilité des deux parties paraît difficile à quantifier, mais je suis tentée de ressortir mes vieux cours d’économie pour donner raison, pour une fois, aux orthodoxes de l’éco : selon la loi de Say, “toute offre crée sa propre demande”… diminuer la production serait donc un point de départ raisonnable.
Les élites polluent, les opprimé.e.s trinquent

En plus d’être constamment tentés par la surconsommation, nous sommes des Occidentaux, avec des modes de vie beaucoup plus polluants que ceux des pays en développement : l’ONG Oxfam, dans son rapport de 2020 sur les inégalités des émissions de CO2, a montré que “les 10% les plus riches de la population mondiale (environ 630 millions de personnes) sont responsables de 52% des émissions de CO2 cumulées.” Concrètement, “l’empreinte carbone par habitant-e des 10 % les plus riches est plus de 10 fois supérieure à l’objectif fixé (environ 2,1 tonnes/an par habitant-e) et celle des 1% les plus riches 35 fois plus élevée.” La responsabilité des plus riches est donc sans équivoque.
Outre les inégalités de richesse, il existe d’autres critères qui s’ajoutent aux inégalités entre nos empreintes carbone : surprise, le genre, la classe et la race, les facteurs structurants d’oppression de notre société, opèrent aussi comme par magie dans les inégalités d’émissions carbone !
Dès 2009, un rapport de l’UNFPA (un fonds de l’ONU) montre que les femmes ont une empreinte carbone moins élevée que celles des hommes, et subissent plus violemment les conséquences du dérèglement climatique. Selon l’étude, elles mangent moins de viande, prennent moins la voiture et l’avion, recyclent plus, et sont globalement plus disposées à se préoccuper des problèmes d’environnement… mais elles sont en plus davantage concernées par les conséquences du dérèglement climatique, de par leur plus forte dépendance à l’environnement (notamment dans l’agriculture), le fait qu’elles soient généralement responsables de la tenue du foyer et donc de ses ressources, et que les foyers dirigés par des femmes, qui sont en moyenne moins riches que les hommes, soient plus affectés par les catastrophes climatiques.
Plus globalement, ce sont les populations les plus opprimées et les plus précaires qui subissent en premier lieu les conséquences du dérèglement climatique : migrations forcées face aux catastrophes climatiques, précarité face aux crises sanitaires et économiques, problèmes de santé liés à la pollution ou à l’alimentation… Les élites polluent, les opprimés trinquent. Comme l’explique Cy Lecerf Maulpoix, auteur d’Écologies déviantes. Voyages en terres queers (Cambourakis, 2021), dans cet article de Mediapart, les crises climatiques et sociales sont beaucoup plus violentes pour “les classes populaires, les personnes racisées, les migrants ou encore les LGBTQI+, notamment les personnes trans et les travailleurs et travailleuses du sexe”. Les confinements à répétition dus à la crise sanitaire ont précarisé les personnes trans, les personnes sans papiers et/ou en attente de soins, ainsi que les travailleur.euse.s du sexe qui ont vu leur activité dégringoler (témoignages ici et là).
Les personnes racisées sont les premières concernées par l’exploitation de certaines terres et de leurs ressources, et en subissent les effets nocifs : le scandale du chlordécone, pesticide toxique utilisé en Guadeloupe et en Martinique de 1972 à 1993 qui a empoisonné les sols, les rivières, la mer et les corps des Antillais.e.s, en est un exemple malheureusement très parlant.
Les courants de l’écoféminisme, de l’écologie décoloniale, de l’écologie queer ou encore de l’écologie politique sont extrêmement pertinents pour comprendre les liens inextricables entre la nécessité de la lutte écologique et de la lutte contre le patriarcat, le colonialisme et le capitalisme.
D’autres indicateurs sont-ils envisageables ?
Récapitulons : l’empreinte carbone permet de quantifier nos émissions carbone, qui sont elles-mêmes très dépendantes de notre mode de vie, de notre identité sociale et du pays dans lequel on vit.
Pour compléter l’indicateur de l’empreinte carbone, et compter non seulement les émissions de CO2 mais aussi les surfaces biologiquement productives nécessaires pour fournir tout ce que nous consommons, l’indicateur de l’empreinte environnementale, ou empreinte écologique, a été forgé. Le test du Global Footprint Network vous donne le détail de votre empreinte écologique (surfaces bâties, forêts, terres cultivées, pâturages, zones de pêche)… et le nombre de planètes qu’il faudrait si tout le monde faisait comme vous.
La limite du concept d’empreinte carbone est très justement pointée par l’article dont je parlais au début : “Nos empreintes carbone ne rendent pas fidèlement compte de notre impact individuel sur la crise climatique. Et en encourageant les personnes écolos à utiliser l’empreinte carbone comme des “guides” pour combattre le changement climatique, on risque de les voir gaspiller leur énergie dans des actions individuelles à faible impact qui sont faciles à quantifier, comme recycler ou éteindre les lumières, au lieu de mettre cette énergie dans un travail plus utile, comme faire du lobbying auprès des politiciens locaux ou identifier les formes de gaspillages au bureau.”
Le vrai gaspillage, ce serait donc de se focaliser uniquement sur le mesurable et sur l’individuel, au détriment d’un changement d’ampleur. Les petits gestes nous rassurent parce qu’ils sont quantifiables, mais ils ont un impact relativement faible et surtout, ils nous détournent de l’essentiel : mettre notre énergie dans un changement de système.
Pour cela, l’article propose le concept “d’ombre carbone”, qui engloberait non seulement notre empreinte carbone mais aussi : “Comment vous votez, combien d’enfants vous choisissez d’avoir, où vous travaillez, où vous investissez votre argent, à quel point vous parlez de changement climatique, et comment vos mots amplifient l’urgence, l’apathie ou le déni.” L’autrice Emma Pattee parle de trois grands piliers dans cette ombre carbone : sa consommation, ses choix de vie (fini donc de travailler dans des groupes pétroliers, par exemple), et son attention (dirigée vers le changement climatique).
L’outil de l’empreinte carbone est donc un diagnostic nécessaire, mais incomplet. D’autant plus que l’article insiste sur un fait important, dont je n’avais jamais entendu parler : le concept d’empreinte carbone a été popularisé… par l’industrie du pétrole. La compagnie britannique British Petroleum (BP) a contribué à ancrer dans les esprits l’idée et la légitimité de cette notion. Elle dévoile en 2004 son outil de calcul de l’empreinte carbone, et l’année suivante, axe une campagne de publicités sur “votre empreinte carbone” (encore récemment également, la communication de BP a porté sur le calcul de “votre” empreinte, toujours à l’échelle individuelle)… Une belle manière de responsabiliser les clients, et de bien se foutre du monde, alors qu’on sait que l’entreprise figure parmi les 40 compagnies les plus polluantes du monde.
La notion d’empreinte carbone contribue donc à envisager le changement climatique sous un angle individuel, sans jamais remettre en question le système dans lequel s’inscrivent nos actions. L’objectif nécessaire et urgent de diminuer nos émissions individuelles via des actions à “fort” impact (à l’échelle individuelle : le régime végétarien, la diminution de l’avion et de la voiture individuelle) ne doit pas évacuer la question cruciale : à qui profite cette comptabilité ? Comment ne pas prendre la culpabilité de la crise climatique à une échelle individuelle, et ne pas s’épuiser dans des actions à faible impact ? Comment changer de système de façon massive ? BP, ainsi que tout le capitalisme fou de croissance, entretiennent de toutes leurs forces le paradigme d’une écologie individuelle (en ne pensant donc jamais le capitalisme comme une donnée qui pourrait ne plus exister), ce qui leur permet de continuer à faire du profit tout en aggravant la crise climatique.
Emma Pattee synthétise : “En promouvant l’empreinte carbone comme la chose la plus importante sur laquelle se concentrer quand on est un citoyen inquiet, l’industrie des énergies fossiles s’est assurée qu’on ne mettrait pas notre énergie sur ce qui compte vraiment : l’action collective et l’activisme”. L’action collective et l’activisme sont donc plus qu’urgents pour passer de l’écologie des petits gestes… à l’écologie des grandes révoltes.