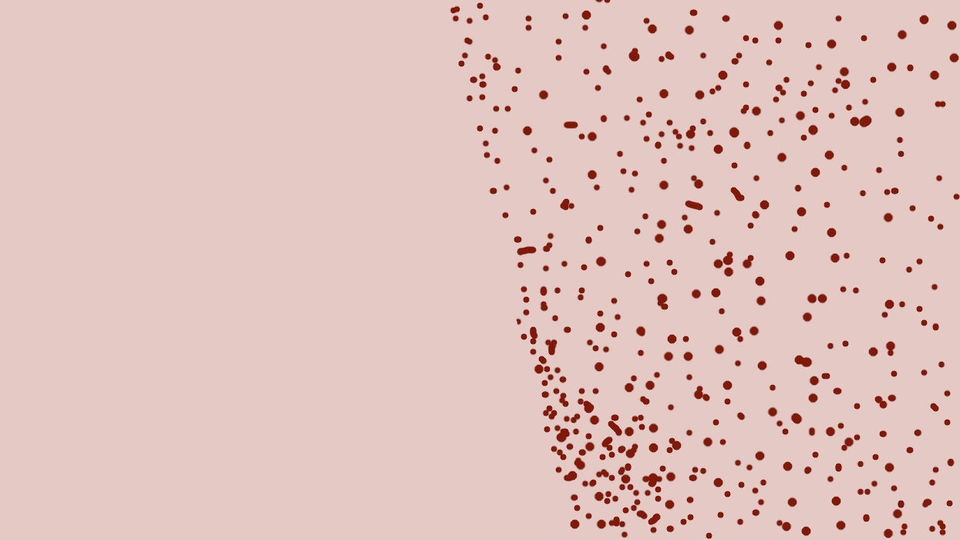11 Septembre : pour les Etats-Unis, vingt ans de fuite en avant
L’Amérique pleure ses morts, les Afghans souffrent et les talibans règnent. Tant de choses ont changé en vingt ans, et si peu à la fois. Du choc planétaire du 11 septembre 2001 avait rapidement émergé la conviction que rien ne serait plus jamais comme avant. C’est vrai à Manhattan où les Twin Towers, prouesse architecturale arrachée aux New-Yorkais, ont laissé place à deux immenses bassins honorant les disparus. Vrai aussi sur Internet, sur nos smartphones ou dans notre façon de voyager, autant de champs de la vie quotidienne contaminés par l’obsession sécuritaire née en ce tragique mardi d’été indien. A Kaboul en revanche, le présent a le goût amer du retour à la case départ. Dans une leçon de patience et de ténacité qu’on trouverait formidable s’il ne s’agissait pas d’eux, les talibans président à nouveau aux destinées de l’Afghanistan, abandonné dans le chaos, de manière assumée et réfléchie, par Washington.
Au moment de commémorer, à New York, au Pentagone et en Pennsylvanie, le vingtième anniversaire des attentats, Joe Biden aura sans doute une pensée, un mot, une prière peut-être, pour les filles et les femmes afghanes de retour sous le joug obscurantiste. Cela ne leur sera d’aucun réconfort et l’essentiel, pour le démocrate, se trouve de toute façon ailleurs. Comme Barack Obama et Donald Trump avant lui, il voulait tourner la page, celle de la guerre la plus longue de l’histoire des Etats-Unis. Celle, aussi, de l’exorbitante «guerre contre la terreur» lancée par George W. Bush en 2001. Biden l’avait promis, il n’a pas tergiversé. Et ce samedi, il tentera de se poser en président d’un peuple uni par la mémoire et le deuil, à défaut de l’être par autre chose.
Pour les Américains, les souvenirs des attentats du 11 Septembre demeurent intacts, aussi indélébiles que la blessure elle-même, la pire jamais infligée à leur pays par un groupe terroriste. Où étaient-ils ? Que faisaient-ils lorsqu’ils ont appris la nouvelle puis découvert en direct, sidérés et impuissants, prostrés ou – déjà – enragés, les images du World Trade Center en feu, les stigmates des Boeing 767 dans ses façades de verre, la fumée noire fendant le ciel bleu immaculé de Manhattan puis l’effondrement impensable des deux tours, à vingt-neuf minutes d’intervalle ? Ils sont 93 %, parmi ceux âgés à l’époque d’au moins 10 ans, à s’en rappeler «précisément», selon une enquête réalisée fin août par le Pew Research Center. Rare trait d’union dans une nation aujourd’hui malade de ses fractures et ses désaccords y compris mémoriels.
Angoisse collective
Quant aux plus jeunes et aux quelque 70 millions d’Américains nés depuis le 11 septembre 2001, ils ont beau avoir grandi sans souvenirs précis, ils n’ont pas échappé au deuil national, patriotique et belliqueux, et à une forme d’angoisse collective surgie ce jour-là. Ce jour où leur pays, hyperpuissance d’un monde unipolaire, perdit à jamais et en quelques minutes une partie de sa quiétude et près de 3 000 vies. Le soir même, le président George W. Bush rendit hommage à ces «secrétaires, femmes et hommes d’affaires, militaires et travailleurs fédéraux, mères et pères, amis et voisins», promettant de leur rendre «justice» et exhortant ses concitoyens à prier pour «les enfants dont le monde a volé en éclats». Comme un lointain écho, le reporter Andrew Boryga, jeune écolier du Bronx à l’époque, écrivait il y a quelques jours dans le Washington Post : «L’effet psychologique de voir son pays attaqué à un jeune âge peut s’exprimer de manière très différente pour chacun au fur et à mesure que les années passent. Mais il ne m’a jamais quitté, et je ne crois pas qu’il ait jamais quitté ma génération non plus.»
Que reste-t-il donc du 11 Septembre, date à laquelle les Etats-Unis ont vacillé, et le monde avec eux ? Une douleur éternelle d’abord, aux yeux des Américains. «Les vingt années écoulées nous ont appris que le temps ne guérit pas toutes les blessures. Le temps, en réalité, ne fait que passer», disserte la professeure Sally Karioth, spécialiste en psychotraumatologie. Elle a accompagné notamment des survivants de l’attaque sur le Pentagone et des enfants ayant perdu un parent au World Trade Center. Symbole de cette plaie encore béante, plus de 1 100 victimes des attentats de New York restent à identifier formellement. Deux l’ont été il y a tout juste quelques jours, grâce à une nouvelle technologie de séquençage de l’ADN. La majorité ne le sera jamais. «Le deuil, la perte et le traumatisme ont marqué à jamais nos histoires personnelles, poursuit Sally Karioth. Ce moment charnière dans la marche du monde est devenu, pour toujours, un fardeau collectif.»
Fardeau collectif

Infligé par Al-Qaeda après des années de préparatifs minutieux, ce fardeau, que même Hollywood n’aurait osé imaginer, a fait dérailler l’Amérique. Le symbole de sa suprématie financière et le quartier général de sa puissance militaire ont été frappés. La riposte n’en a été que plus brutale. Voilà que le bras vengeur de Washington s’abat – avec, parfois, le concours de ses alliés – et que le fardeau américain devient mondial. L’Amérique projette sa force brute sans réfléchir aux conséquences. La guerre en Afghanistan débute le 7 octobre 2001, celle d’Irak le 20 mars 2003. La première a pris fin il y a quelques semaines, avec en guise d’épilogue un pont aérien frénétique et endeuillé par un énième attentat aux portes de l’aéroport de Kaboul (plus d’une centaine de morts, dont 13 militaires américains).
Depuis, les talibans ont annoncé leur nouveau gouvernement par intérim. Ceux qui espéraient qu’ils se soient modérés en une sorte de version 2.0 après leur premier exercice du pouvoir entre 1996 et 2001 ont déchanté. Leur exécutif rassemble une partie de la vieille garde, proche du mollah Omar avec qui ils ont fondé le mouvement, passée par Guantánamo et sur la liste noire de l’ONU. Les plus jeunes ont aussi de quoi faire frémir : le mollah Yacoub, fils du mollah Omar et dirigeant de la commission militaire de l’organisation, ou Sirajuddin Haqqani, actuel numéro 2 des talibans à la tête mise à prix par le FBI et dirigeant du réseau Haqqani. Ce groupe fait l’interface avec Al Qaeda dans la région et a commis ou commandité les attentats les plus sanglants qui ont frappé Kaboul ces quinze dernières années.
A lire aussiAfghanistan : les Haqqani, dynastie de la terreur
International21 août 2021abonnésIl a fallu à peine trois semaines aux talibans pour commencer à repeindre les murs de béton posés par les forces de l’Otan et les autorités afghanes dans la capitale avec leurs slogans : «Nous avons conquis l’Afghanistan et battu les Américains avec l’aide de Dieu» ou «Le Coran est la loi». Et à réimposer leur ordre par la force, hurlant et tapant avec des bâtons et des tuyaux en plastique les quelques femmes qui osent protester dans la rue. Un Kaboul souterrain s’est creusé, empli de ceux qui ont peur, se cachent, et ne sortent plus dans les rues. Il ne cesse de s’étendre à mesure que l’évidence se fait jour : les talibans n’ont pas changé. Le pays, lui, sombre. Selon le Programme de développement des Nations unies, 97 % des habitants risquent d’avoir moins d’un dollar par jour – le seuil de pauvreté – pour survivre d’ici le milieu de l’année prochaine, contre 72 % aujourd’hui.
929 000 morts
«Toutes les guerres se jouent deux fois, d’abord sur le champ de bataille, puis dans la mémoire collective», écrivit en 2016 le romancier vietnamo-américain et ancien réfugié Viet Thanh Nguyen. Sur celle d’Irak, déclenchée sans preuves ni stratégie d’avenir et qui créa le chaos propice à l’émergence de Daech, la mémoire collective s’est déjà forgé une opinion assez tranchée. Qu’en sera-t-il du cas afghan ? Entre le retour éclair des talibans au pouvoir et le départ humiliant de leurs propres soldats, les Etats-Unis semblent avoir perdu à la fois la guerre du terrain et celle de l’image. Mais, l’universitaire Gus Martin, spécialiste du terrorisme, nuance : «Nous sommes intervenus en Afghanistan pour chasser Al-Qaeda et éliminer cette menace. On peut dire que cette mission a été couronnée de succès quand nous avons tué Oussama Ben Laden en 2011. Peut-être aurions-nous dû, alors, déclarer notre victoire et rentrer à la maison.»
Professeur à la California State University, Martin insiste aussi sur le fait que les Etats-Unis ont été relativement épargnés par le terrorisme. «Nous nous attendions à davantage d’attaques de masse. Depuis le 11 Septembre, cela ne s’est pas produit aux Etats-Unis, contrairement à l’Europe – à Bruxelles, à Paris, à Londres…», détaille l’expert, pour qui les «loups solitaires radicalisés» et les «terroristes intérieurs» constituent désormais la «principale menace». A l’aune de cette absence de tueries perpétrées sur son sol par des terroristes venus de l’étranger, les deux décennies écoulées auraient donc permis de rendre l’Amérique plus sûre. Mais à quel prix ? La Brown University a tenté d’évaluer «les coûts réels» – humains, budgétaires et même environnementaux – des «guerres post-11/09». Forcément imparfaits, les chiffres n’en demeurent pas moins vertigineux : plus de 929 000 morts dont 387 000 civils, 38 millions de réfugiés et plus de 8 000 milliards de dollars dépensés rien que par Washington, en incluant les soins futurs pour les vétérans.
S’y ajoute le coût moral et démocratique. «L’Amérique a été prise pour cible parce que nous sommes le phare le plus brillant de la liberté et des opportunités dans le monde. Personne n’empêchera cette lumière de briller», clamait George W. Bush au soir du 11 Septembre. Mais blessé dans son orgueil, le soi-disant «phare» américain a surtout montré sa face la plus sombre : prisons secrètes de la CIA, enlèvements et tortures de prisonniers, «ennemis combattants» traités comme des bêtes au camp militaire de Guantánamo et privés, comme les victimes d’ailleurs, d’une justice démocratique. En vingt ans, les Etats-Unis n’ont jamais réussi à juger les cerveaux des attentats, qu’ils détiennent pour certains depuis 2003. Par une étrange coïncidence, l’ouverture mercredi à Paris du procès du 13 Novembre – «cette démonstration de force de la loi, de la démocratie» selon François Hollande – a rappelé qu’une autre voie était possible. Enfin, comment ne pas évoquer les innombrables dérives liées à l’obsession sécuritaire ? Le tentaculaire Patriot Act, la surveillance de masse généralisée, y compris celle des alliés, au nom de la primauté d’une «logique de la suspicion», résume Didier Bigo du Centre de recherches internationales (Ceri).
A lire aussi11 Septembre : vingt ans après, un nouveau monde
International10 sept. 2021Force déstabilisatrice à l’étranger et en premier lieu au Moyen-Orient, où son aventurisme militaire a rompu de fragiles équilibres, nourri les guerres civiles et créé davantage de djihadistes qu’elle n’en a éliminés, l’Amérique de ce début de siècle s’est aussi retrouvée fragilisée à l’intérieur de ses frontières. Le profilage racial, la militarisation outrancière des forces de police ou la «sécurisation du débat sur l’immigration», selon l’expression du politologue David Leblang, sont autant d’héritages du 11 Septembre. Tout comme, estime l’écrivain Douglas Kennedy, l’élection de Donald Trump, «résultat direct de la peur xénophobe engendrée par ce monstrueux attentat».
Sénateur en 2001, aveuglé lui aussi par la rage et le désir de vengeance, Joe Biden avait soutenu sans sourciller l’intervention en Afghanistan puis la guerre en Irak. Vingt ans plus tard, il ambitionne d’être le président d’une autre Amérique. Une Amérique moins obnubilée par le risque terroriste et davantage tournée, disait-il le mois dernier, vers «les menaces de 2021 et de demain». Ces dernières ne manquent pas : la compétition stratégique avec la Chine, le changement climatique et la pandémie de Covid-19. En plein rebond, cette dernière a déjà fait aux Etats-Unis 220 fois plus de morts que le 11 Septembre tout en mettant en lumière les failles sociales et sanitaires d’une hyperpuissance à nouveau fragilisée. De cette catastrophe, Joe Biden a tiré une leçon majeure : il est grand temps de faire du nation building. Mais cette fois, à domicile.