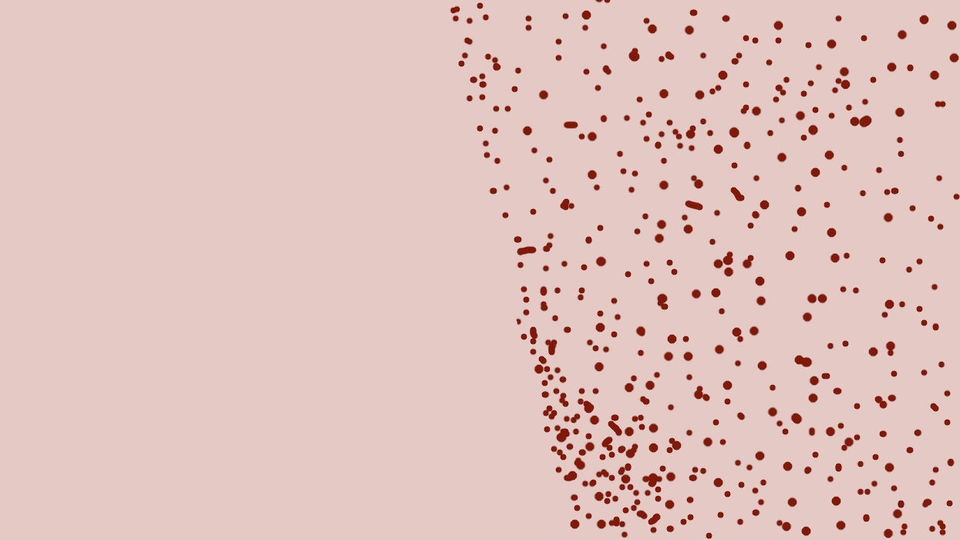La course infernale des producteurs de lait, par Maëlle Mariette (Le Monde diplomatique, février 2021)
Dans un gigantesque bâtiment de cinq mille mètres carrés, des centaines de vaches qui ne fouleront jamais l’herbe déambulent sous de grands ventilateurs-brumisateurs qui tournent silencieusement. À intervalles réguliers, de petits wagonnets parcourent le corps de ferme sur leurs rails, circulant d’un silo de stockage à l’autre, mélangeant les aliments et distribuant les rations. Dans l’étable, rebaptisée « stabulation », les vaches vont et viennent autour de quatre imposantes machines rouges. Ce sont des robots de traite. Attirées par une ration de granulés, elles viennent s’y placer à tout moment du jour et de la nuit, laissant les portes se refermer le long de leurs flancs. Le processus est entièrement automatisé : le robot commence par identifier la vache grâce à son collier électronique, puis il détecte l’emplacement de ses pis au moyen d’une caméra intégrée. Débarrassés de leurs saletés par un rouleau nettoyeur, ceux-ci sont ensuite scannés par un laser 3D rouge qui détermine la localisation des mamelles au millimètre près. La machine y place alors ses gobelets trayeurs : la traite peut commencer.
En ce mois de septembre 2020, une journée portes ouvertes est organisée à l’exploitation agricole des Moulins de Kerollet, à Arzal, dans le Morbihan. M. Erwan Garrec, éleveur laitier d’une quarantaine d’années, a fait une heure de route pour assister à cette démonstration du dernier robot de traite de la marque Lely, qui domine le marché. Investir dans un tel système, « c’est s’offrir les services d’un “employé modèle”, capable de traire vos vaches vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pendant de nombreuses années », vante la brochure du groupe. « Ça vous dégage du temps et vous libère des contraintes liées à la traite », commente un vendeur du stand, avant de préciser : « À la moindre anomalie ou panne, vous recevez une alerte sur votre smartphone. » Grâce à son système de traite en continu, ce robot « permet d’augmenter facilement votre production de 10 à 15 % ».
M. Garrec n’a pas de smartphone, mais il rêve de la liberté qu’offrirait pareille technologie, lui qui s’occupe seul d’une grosse centaine de vaches laitières et travaille sans relâche plus de quinze heures par jour, trois cent soixante-cinq jours par an. Mais la liberté a un prix : s’offrir les services d’un de ces « employés modèles » impliquerait de débourser 150 000 euros, sans compter les 12 000 euros annuels de maintenance et les travaux d’aménagement à effectuer dans le bâtiment. Il faudrait de plus en changer tous les dix ans. Et, comme l’automate sature à partir d’une soixantaine de vaches, son exploitation en exigerait deux. Le vendeur le rassure : « Pour l’emprunt, on peut s’arranger. Le Crédit agricole encourage ses clients à se moderniser. Nous, on les connaît bien. »
Des emprunts, M. Garrec en a déjà contracté plusieurs. Pour son bâtiment, d’abord. Comme il a dû doubler le nombre de ses vaches afin de garantir la survie de son exploitation, il a fallu agrandir la ferme familiale, qui ne suffisait plus : une salle de traite plus vaste, un second silo pour stocker davantage de maïs. Et, comme il fallait plus de maïs, il a fallu doubler le nombre d’hectares destinés à en produire, et donc acquérir de nouveaux tracteurs. M. Garrec produit aujourd’hui un million de litres de lait par an, soit trois fois plus que la moyenne des éleveurs laitiers français.
« On prend des risques, on investit »
Une telle performance implique une course quotidienne contre la montre. Chaque matin, M. Garrec franchit en courant la centaine de mètres de pâturages qui séparent sa maison — construite sur l’une des parcelles de son exploitation — du bâtiment où se trouvent les vaches. Vêtu d’un bleu de travail, un seau à la main, il court encore, cette fois d’un bout à l’autre de sa stabulation de deux mille mètres carrés où flotte l’odeur nauséabonde du maïs ensilage (1). Ses gestes sont répétitifs et ajustés au centimètre près, pour économiser de précieuses secondes. Ce matin, il jette un coup d’œil rapide à sa montre et lance : « Ça va, on est dans les clous ! »
« Grâce à cette alimentation, les vaches sont plus performantes », nous explique-t-il. Et puis, les faire pâturer s’avérerait chronophage, car elles sont nombreuses. Mais ce régime alimentaire coûte cher. Le maïs, qui vient de ses champs alentour, constitue son « plus gros poste de dépenses » : il nécessite des semences, des intrants, de l’irrigation et du travail agricole — externalisé par manque de temps.
Le maïs ensilage étant dépourvu de protéines, les rations distribuées aux vaches s’accompagnent de granulés de soja génétiquement modifié venu d’Amérique latine, ainsi que de minéraux et d’oligo-éléments en poudre. Les vaches de M. Garrec sont des prim’Holstein, une race réputée pour être la plus productive du monde. « Le problème, c’est qu’elles sont fragiles. Il y a donc des frais de vétérinaire importants. » L’éleveur a cependant pu améliorer la productivité de son cheptel en recourant aux services de la coopérative d’insémination et de génétique animale Évolution. Son catalogue de plus d’une centaine de taureaux permet d’améliorer les performances des vaches, en adaptant par exemple leur morphologie (taille et hauteur de la mamelle, notamment) aux caractéristiques de la trayeuse. Cela n’empêche pas que 30 % du troupeau parte à l’abattoir chaque année en raison de mamelles non standards et de pis inadaptés. La proportion monterait à 50 % avec le calibrage du robot Lely Astronaut.
« On a un travail répétitif comme celui d’un ouvrier. Mais nous, on est notre propre patron. On prend des risques, on investit, on fait vivre et travailler plein de gens », développe M. Garrec en branchant inlassablement ses vaches aux trayeuses. À vrai dire, c’est d’abord Lactalis, numéro un mondial des produits laitiers et treizième groupe agroalimentaire de la planète, que notre agriculteur fait vivre. « Là, je suis en train de produire le lait du mois de septembre, mais je ne sais pas encore à quel prix je le vendrai. » Car, dans la filière, c’est le client (ici Lactalis, mais il en va de même avec ses concurrents) qui fixe le prix et qui facture le produit, envoyant tous les mois au producteur sa « paye de lait ». Le contrat qui lie les deux parties ne fixe pas le prix, mais le nombre de litres qui doivent être produits.
Il est 1 heure du matin lorsque la course folle de M. Garrec prend fin. Après la traite du soir, il éteint la lumière du bâtiment et parcourt les pâturages en sens inverse, dans la nuit noire, guidé par la lumière de son téléphone, deux bouteilles de lait encore chaud à la main. Fourbu, il avale, avant de se coucher, un Nesquik dans lequel il a jeté de la semoule : « Ça prend cinq minutes. » Dans quelques heures, tout recommence.

Comme la plupart des éleveurs de la région, et à l’instar des ouvriers à la chaîne, M. Garrec ne sait pas ce que va devenir le fruit de son labeur : « De la mozzarella ou de la poudre de lait, peut-être ? » Et il s’agit de ne pas émettre de réserves à propos des produits finaux, ni, surtout, de protester contre l’entreprise, même lorsqu’elle impose aux éleveurs des conditions difficilement compatibles avec leur survie. Comme l’explique M. Bernard Le Bihan, éleveur laitier proche de la retraite, le contrat qui lie les producteurs à Lactalis contient « une clause qui interdit l’atteinte à l’image de l’entreprise ou de ses produits ». Nul ne peut se permettre de rompre avec l’entreprise qui, chaque année, en France, transforme plus de cinq milliards de litres de lait (de vache, essentiellement, mais aussi de brebis) en produits qui inondent les rayons des supermarchés : camembert Président, roquefort Société, lait Lactel, petits pots La Laitière, mozzarella Galbani, imitation de feta Salakis, etc.
M. Garrec loue les succès commerciaux de Lactalis : « Ils font de la plus-value et leurs produits sont recherchés. Ils innovent, ils vont de l’avant, ils ne cessent de se développer. Ils ont encore racheté plusieurs laiteries cette année. » Les techniciens de la société qui passent régulièrement à sa ferme tiennent le même discours. Il s’agit pour eux de « garder un œil sur les producteurs, sur leur manière de travailler, pour voir s’il y a un problème. Par exemple, si l’étable est très sale, on dit de nettoyer un peu, parce qu’on a une image à tenir en tant que leader mondial », nous explique M. Nicolas Huet, technicien Lactalis. Il s’agit aussi de régler des problèmes de qualité du lait, le plus souvent en conseillant aux producteurs « de faire appel à un contrôleur laitier pour les aider », sous peine de voir le géant mondial « arrêter de ramasser leur lait ». La prestation de base de ce service est facturée environ 12 000 euros par an par les entreprises de conseil en élevage.
Ces dernières ne sont pas les seuls prestataires de services qui gravitent en permanence autour des éleveurs. « Quand on va chez les agriculteurs, on doit aussi vendre des produits : un bac à eau pour faire boire les vaches, des produits pour l’hygiène de la mamelle, des conservateurs pour l’ensilage…, nous explique M. Huet. Ce qui est un peu délicat, c’est qu’on achète le lait au producteur et qu’on ne paie pas très bien. Alors, après, leur vendre quelque chose… Parfois, ça ne passe pas trop. Je le sais bien, car mes parents sont éleveurs laitiers ; parfois, ça me met mal à l’aise. Mais, pour être bien vu de Lactalis, il faut vendre… L’avantage, c’est qu’on a tous les résultats des producteurs, donc on sait où sont leurs faiblesses. Pour la vente, c’est un outil précieux : on connaît les points qu’ils doivent améliorer. »
Au fil des visites, la relation commerciale en enfante souvent une autre, plus intime : « On est les personnes qu’ils voient le plus, et nos échanges tombent parfois dans le registre du social ou de la psychologie. Il m’est arrivé de rentrer dans une étable et de voir les gens en train de pleurer. » Et si, tel M. Garrec, les agriculteurs sont conscients du fait qu’il s’agit avant tout de leur « refourguer le plus de trucs possible » dans un « défilé permanent de charlatans dont chacun vient avec ses nouveaux produits tous plus révolutionnaires les uns que les autres », Lactalis parvient à se démarquer grâce à un atout de taille : non seulement l’entreprise « vend de tout » là où d’autres sociétés d’agro-fournitures sont plus spécialisées, mais elle « vend même aux agriculteurs les plus endettés, car elle prélève ce qui est dû directement sur la paye de lait ; elle est donc sûre d’être payée, contrairement aux autres marchands de fournitures, qui peuvent refuser de vendre ». Comme beaucoup d’agriculteurs se retrouvent ainsi endettés auprès de leur groupe agro-industriel, « ils ne peuvent pas aller ailleurs ». « C’est la base du système », explique M. Patrick Danzé, professeur de gestion à la retraite dans un lycée agricole de la région.
Un quart des agriculteurs sous le seuil de pauvreté
Mais les éleveurs sont surtout endettés auprès des banques. Celles-ci ont en effet ouvert tout grand les vannes du crédit, soutenant les investissements que les agriculteurs sont de toutes parts poussés à faire. Les concessionnaires de matériel agricole ne vendent pas tant des machines que les plans de défiscalisation par l’investissement vantés par des conseillers de centres de gestion. « Ils m’ont dit : “Il faut investir pour que ton exploitation ne perde pas de la valeur et pour payer moins de charges et moins d’impôts” », nous raconte un agriculteur. Les investissements effectués étant comptabilisés comme des charges d’exploitation, ils diminuent le résultat, et donc le montant de l’imposition. Le problème, explique M. Danzé, « c’est que votre trésorerie plonge dans le rouge, et que les agios s’accumulent. En bout de course, vous finissez par travailler pour les banques ». Il poursuit : « Ici, en Bretagne, le taux moyen d’endettement bancaire et auprès des fournisseurs est d’environ 70 % de l’actif pour les exploitations laitières. À ces taux-là, on est très vulnérable. À la première crise sanitaire, climatique ou économique, tout bascule. »
Selon M. Ronan Mahé, lui aussi éleveur, cette fragilité trouve également son principe dans le fait que, « depuis trente ans, le prix du lait n’a pas changé, et a même baissé ; pendant ce temps-là, tout a augmenté : aliments, matériel, charges, cotisations, mises aux normes, etc. ». Plus du quart des paysans vivent ainsi sous le seuil de pauvreté, avec des revenus souvent inférieurs au revenu de solidarité active (RSA). Ils sont la catégorie socioprofessionnelle la plus touchée par la misère. En 2017, près de 20 % d’entre eux ont déclaré un revenu nul, voire un déficit de leur exploitation (2).
Le patron de M. Mahé se nomme Emmanuel Besnier. Il préside le groupe Lactalis, créé par son grand-père. En juin 2020, à Saint-Faron, dans l’une des plus petites laiteries du groupe, où sont « moulés à la louche et selon les recettes historiques » les bries de Meaux et de Melun, il annonçait que Lactalis avait atteint 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, « avec un an d’avance sur ses objectifs ». Au cours de cette année « historique », le groupe a connu sa plus forte croissance, avec notamment neuf acquisitions. La fortune de M. Besnier a suivi la même progression, le hissant à la neuvième place du classement Challenges des personnes les plus riches de France (il est depuis redescendu à la onzième place). Lors d’une conférence de presse, il a également annoncé que le prix du lait allait encore baisser, « pour affronter les difficultés qui s’annoncent dans le secteur laitier » en raison de la pandémie de Covid-19 (3). « Il y a une course à la baisse entre les industriels, explique M. Le Bihan. Ils tirent les prix vers le bas pour dégager de la marge et rester concurrentiels. Lactalis, Sodiaal [première coopérative (4) laitière française] et les autres tiennent tous le même discours. »
Il n’y a pas si longtemps encore, les prix étaient encadrés par le système des quotas laitiers, mis en place en 1984 dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). En attribuant à chaque exploitation un quota de production (au-delà duquel des pénalités financières s’appliquaient), ce système européen garantissait aux agriculteurs des prix relativement élevés grâce à la maîtrise des volumes produits. Il s’agissait de juguler les excédents engendrés par une politique productiviste dont le but initial était l’autosuffisance alimentaire de l’Europe après la seconde guerre mondiale. En 2015, arguant de la lourdeur et du coût de cette régulation des marchés agricoles, Bruxelles décida d’y mettre un terme, dans la continuité d’une logique de désengagement progressif de la puissance publique.
Les agriculteurs ont alors été confrontés à une nouvelle donne : des marchés qui ne sont plus protégés et des prix instables, soumis au bon vouloir de laiteries de moins en moins nombreuses. Parmi les vingt leaders mondiaux du secteur, cinq sont français (Lactalis, Danone, Savencia, Bel et Sodiaal), ce qui fait de l’Hexagone le pays le plus représenté dans ce classement. Alors que l’industrie laitière est la première industrie agroalimentaire de France et que le marché du lait y atteint 29 milliards d’euros par an, ces grands groupes dictent leur loi aux 80 000 producteurs français, puisqu’ils assurent l’essentiel de la collecte de leur lait. Le « bas de la chaîne » n’a d’autre choix que d’accepter les conditions des collecteurs de sa région, qu’une main invisible semble harmoniser : « Moi, je suis Sodiaal, et mon voisin Lactalis, mais c’est le même camion qui nous ramasse, s’amuse M. Michel Corlay. Ils s’arrangent entre eux. Ça me fait bien rigoler ; ce n’est pas de la concurrence. Sur les prix aussi, ils sont pareils, au centime près. » Mais gare à celui qui s’aviserait de changer de laiterie : « C’est dangereux, car personne ne te prendra en face ! » Les groupes s’accordent en effet pour s’épargner une coûteuse lutte de captation de producteurs. C’est ainsi que MM. Garrec et Mahé sont « chez Lactalis » comme leurs pères, et que MM. Corlay et Éric Jégo sont « chez Sodiaal » comme les leurs. « Quand tu reprends une ferme, tu reprends ses quotas et sa laiterie », résume M. Mahé.
Usure physique et mentale
À l’annonce de la fin des quotas laitiers, on a dit aux éleveurs : « C’est une chance, la demande mondiale est en hausse, le marché mondial est à vos pieds ! », relate M. Corlay, alors aux premières loges. L’emballement qui s’est ensuivi a conduit bon nombre d’entre eux à suivre la même feuille de route : produire plus et mieux s’équiper, dans la perspective de voir s’envoler le prix du lait. Comme beaucoup, M. Mahé et son épouse Sylvie ont effectué d’importants travaux dans leur exploitation. La fin du système des quotas a ainsi entraîné une explosion de la production, qui, couplée aux fluctuations de la demande mondiale, a provoqué une chute des prix.
C’est alors que sont apparues les organisations de producteurs (OP), qui réunissent des éleveurs livrant à un même industriel. Elles se chargent de négocier les contrats pour eux. Responsable d’une des vingt OP négociant avec Lactalis, M. Le Bihan nous raconte : « Négocier avec une multinationale, ça ne se fait pas comme ça. Le rapport de forces est déséquilibré. » Tous les deux mois, il quitte la ferme familiale, où il élève cent cinquante vaches laitières avec ses deux associés, pour aller négocier avec les « grands directeurs » de Lactalis, rodés à l’exercice. « C’est un métier, négocier : il faut sentir les points de rupture, les limites à ne pas dépasser, les coups fourrés. Certains d’entre nous sont allés suivre des formations à Paris. En dix ans, on a beaucoup appris, et on a avancé sur quelques petits points annexes. Mais sur le prix du lait, rien… »
Le combat des éleveurs, explique M. Le Bihan, c’est de « faire entrer les coûts de production dans le calcul du prix du lait. Car nos charges augmentent constamment. Pendant quelques années, on a pu un peu compenser la chose par les volumes ou par l’automatisation, mais ça a ses limites. Avec l’automatisation et la technique, le volume de production par personne a augmenté, mais les journées ne font que vingt-quatre heures ; l’usure physique et mentale de courir après le prix, il y a un moment où ça ne tient plus. » Or, poursuit-il, « la laiterie a peur de manquer de lait, et si beaucoup de gens arrêtent par manque de rentabilité, alors… ». Pour neutraliser cette menace, il suffisait d’amener les exploitations, dont le nombre ne cesse de diminuer, à accroître leur production. M. Fabien Choiseau, directeur de l’approvisionnement en lait de Lactalis, chargé des négociations avec les producteurs, nous explique les choses en ces termes : « Comme il y a une restructuration constante des exploitations avec des producteurs qui arrêtent, notre but est d’accompagner cette restructuration et de proposer aux éleveurs les transferts de volumes nécessaires pour garantir l’approvisionnement de Lactalis. Nous les accompagnons dans leurs projets de développement. Nous sommes là pour les producteurs. » M. Garrec analyse les choses autrement : « Ils n’augmentent jamais le prix du lait, mais, pour faire plaisir et pour que les gens ne disent rien, ils donnent des volumes supplémentaires. Et puis, chaque année, on doit produire un peu plus pour gagner la même chose, car les charges augmentent. On a toujours besoin de volumes en plus, et ils le savent. »
« À un moment, il faut arrêter de se plaindre »
Quant aux OP, M. Garrec note qu’il vaut mieux s’en remettre à elles qu’aux syndicats pour défendre leurs intérêts : « Je ne milite pas trop, car sinon on est mal vu, et parfois même pénalisé. » « Quand on négocie, on ne manifeste pas, résume M. Le Bihan. Depuis qu’il y a les OP, il y a beaucoup moins de manifs. » Lactalis apprécie, qui n’hésite pas à « créer des dissensions » entre les OP avec lesquelles il traite « en donnant une fois à l’un, une fois à l’autre ».
Et si les éleveurs n’ont rien obtenu concernant l’augmentation du prix du lait, peut-être est-ce aussi en partie parce que la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), majoritaire, n’y trouve rien à redire : « Moi, je dis qu’il faut arrêter de fantasmer sur un prix du lait à 400 euros les mille litres. On est dans une économie mondiale et il y a des réalités de marché », assène M. Bruno Calle, cadre de la FNSEA et chef d’exploitation des Moulins de Kerollet.
« L’autre problème », pour M. Calle, c’est que « la notion de chef d’entreprise n’est pas dans l’ADN de tout le monde ; à un moment, il faut prendre un peu de hauteur, écouter les conseils du comptable ou du banquier, et arrêter de se plaindre. Quand mon comptable me raconte que parfois, lorsqu’il fait la remise des résultats de l’année, l’agriculteur s’endort ou lui dit : “Tu as une heure, montre en main, car après j’ai du travail”, ça ne va pas ». Il faut aussi, développe-t-il, « se poser les bonnes questions, se demander : “Comment est-ce que je peux diversifier mon activité ?” Plutôt que de subir, agir. Dans notre métier, il faut être décideur. À cœur vaillant rien d’impossible ! ».
À la mi-septembre 2020, au moment même où M. Besnier savourait la réussite de Lactalis, « exemple presque parfait des succès du capitalisme familial à la française », lors de « son anniversaire, avec sa femme et ses trois enfants, en vacances à l’île de Ré (5) », M. Garrec nous confiait, assis à la table de son salon aux murs nus, face à la fenêtre par laquelle il voit passer ses vaches, qu’il rêvait de « fonder une famille ». Avant d’ajouter avec un soupçon d’angoisse dans la voix que, célibataire à 43 ans, il avait intérêt à ne plus traîner. Mais encore faudrait-il qu’il puisse « consacrer du temps » à sa famille, ce qui signifierait « soit prendre un employé, soit prendre un robot » — comme le Lely Astronaut dont il observait attentivement la démonstration quelques jours plus tôt. Or, dans les deux cas, cela impliquerait « de produire plus, pour compenser le coût ». Et donc de poursuivre sa course infernale contre le temps.