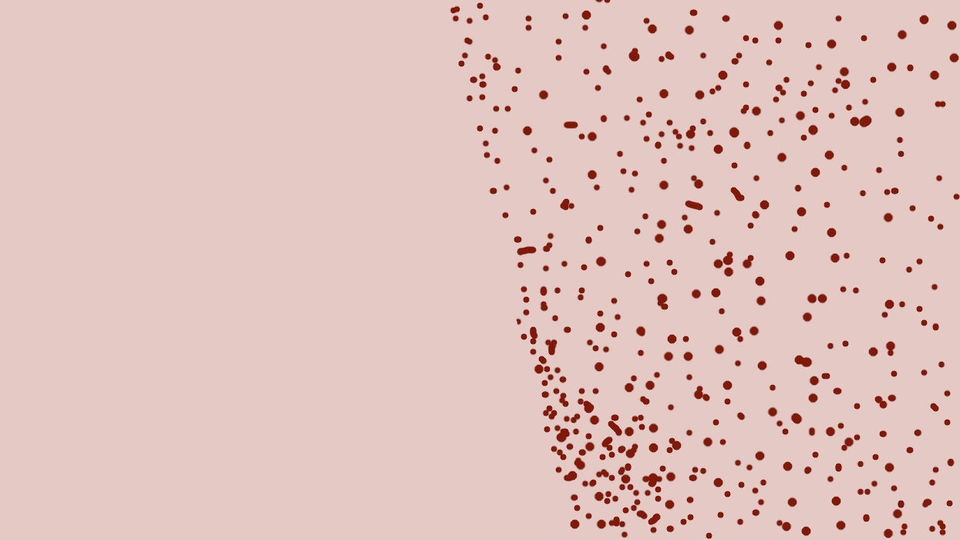Le retour fracassant de la fourrure | National Geographic National Geographic National Geographic
Les peaux de bêtes sont présentes dans près des deux tiers des défilés des plus importantes collections féminines de l’automne-hiver 2017. Alors qu’elle était violemment décriée dans les années 1990, la fourrure fait aujourd’hui un retour en force. Notre journaliste a enquêté.
En cette journée de la mi-février, il gèle à pierre fendre. Nous nous extrayons d’une zone humide prise par la glace sur plus de 20 cm de profondeur. Bill Mackowski, trappeur depuis soixante ans, exerce surtout dans le nord de l’État du Maine. Il me montre des branches d’aulne pointant à travers la glace. Les castors, m’explique-t-il, ramassent le bois des peupliers dès les premiers froids, avant d’empiler des aulnes non comestibles pour faire ployer les peupliers sous la glace et les manger durant l’hiver. Le trappeur transperce la surface gelée à l’aide d’une barre de fer, puis élargit le trou et tire sur quelque chose. Un instrument en acier crève la surface boueuse – un piège brutalement refermé sur la nuque d’un énorme castor.
« C’est ce qu’on appelle une super-couverture, annonce Bill Mackowski. Une belle bête. » La peau ne lui rapportera pas plus de 25 dollars mais, sur le chemin du retour, il affiche la satisfaction que des milliers de générations de chasseurs et de trappeurs ont éprouvée devant leurs prises. Il cite les mots d’un visiteur venu un hiver précédent : « Si les gens parvenaient à faire abstraction de la mort des castors, ils paieraient pour venir ici. »
En réalité, faire abstraction de la mort des animaux ne semble déjà plus être le souci. Des top-modèles ayant posé nues pour une campagne affirmant « Plutôt à poil qu’en fourrure » font aujourd’hui leur carrière dans la fourrure de mode. Des créateurs qui « avaient peur d’y toucher » voilà quinze ou vingt ans ont, eux aussi, « brisé le tabou », m’explique Dan Mullen, un éleveur canadien de visons.
Beaucoup d’acteurs du secteur admettent aujourd’hui que les campagnes virulentes des militants anti-fourrure avaient raison sur un point : les conditions de vie des animaux dans les élevages étaient indécentes. Et d’ajouter que le commerce a changé – ce que contestent ses détracteurs. En tout cas, de plus en plus de gens jugent que porter ou non de la fourrure relève d’un choix individuel.
Les élevages dominent le marché de la fourrure. Leur production a plus que doublé depuis les années 1990. En 2015, elle a atteint environ 100 millions de peaux – surtout de vison, et de renard dans une moindre mesure. Les trappeurs y ont ajouté des millions de castors, coyotes, ratons laveurs, rats musqués et d’autres animaux sauvages. Sans compter des millions et des millions de bovins, agneaux, lapins, autruches, crocodiles, alligators et caïmans, tués à la fois pour leur viande et leur peau.
Naguère attribut de l’élégance bourgeoise hivernale, la fourrure est devenue hip-hop et jeune. Elle s’affiche en toute saison, de toutes les façons : coussins, porte-monnaie, porte-clés, talons aiguilles, sweat-shirts, écharpes, meubles, abat-jour… Il y a des manteaux de fourrure aux motifs de camouflage, d’arc-en-ciel ou dignes des constructions impossibles de M. C. Escher.
Comment la fourrure a-t-elle réussi ce retour fracassant après l’ostracisme qui la frappait dans les années 1990 ? Après la sinistre réputation acquise dans les années 1960, quand ce commerce menaçait la survie du léopard, de l’ocelot et d’autres espèces ? L’utilisation d’espèces en danger a été interdite dans les années 1970. Mais le renouveau actuel est celui d’un secteur qui a su répondre à ses détracteurs – et, souvent, à se jouer d’eux –, tandis que la demande des nouveaux riches croissait en Chine, en Corée du Sud et en Russie.
Je dois avouer ici que j’aborde ce reportage avec un point de vue particulier. Mon arrière-grand-père était trappeur, et je crois que la connaissance intime des choses qu’apportent la chasse, la pêche et le travail avec les créatures vivantes s’est largement perdue dans nos vies urbanisées. Je dois ajouter que mon épouse et moi avions hérité d’une veste en ocelot constituée de quinze peaux, qui nous ont hantés jusqu’à ce que nous la donnions à une réserve de faune comme un objet éducatif. J’ai donc voulu aller voir de mes propres yeux.
Je roule en pleine tempête de neige vers le nord et la Nouvelle-Écosse, au Canada, l’un des centres du commerce des peaux. Dan Mullen m’a invité à voir comment vivent ses visons. Et comment ils meurent.

Mullen a grandi dans la vieille tradition de l’élevage des visons : longs et étroits abris en bois ouverts sur le côté, avec des rangées de petites cages étriquées de part et d’autre. Quand il a lancé sa propre affaire, il a opté pour des cages plus larges, comme celles exigées en Europe. Il en a installé six rangées dans des étables longues de plus de 100 m, au toit en plastique translucide.
Plusieurs fois par jour, un employé conduit un petit véhicule le long des allées, déposant sur le toit de chaque cage un repas élaboré scientifiquement et réparti par ordinateur (on dirait du hamburger cru). Une conduite hors gel fournit de l’eau 24 heures sur 24. Sous les cages, une gouttière mobile emporte les excréments, transformés en fertilisants ou en électricité dans un biodigesteur (minicentrale produisant du gaz).
Ces changements sont intervenus en grande partie sous la pression des défenseurs du bien-être animal. Mais les éleveurs ont souvent su en tirer parti. Par exemple, les cages de Mullen sont toutes pourvues d’une étagère en hauteur qui permet à la mère allaitante de s’éloigner de ses petits (des mères moins dérangées élèvent des petits en meilleure santé). Dans la cage, des jouets réduisent le stress, ce qui donnerait des peaux de meilleure qualité. Paradoxe : les acteurs du secteur se vantent de réformes auxquelles les ont contraints leurs vieux adversaires.
Les visons de Dan Mullen sont d’une taille et d’une santé surprenantes. Ils mesurent le double de leurs congénères sauvages, et ont de grands visages curieux. Ils n’en sont pas moins condamnés. Je suis venu les voir mourir.
Les employés portent des gants de soudure pour éviter les morsures. Ils passent de cage en cage, et soulèvent chaque animal par la base de la queue. Quelques bêtes poussent des cris stridents, mais la plupart sont visiblement habituées à ce traitement jusqu’à ce qu’elles tombent à travers la porte battante du box d’assommage tels des paquets dans une boîte aux lettres. Du monoxyde de carbone leur fait perdre connaissance en moins de soixante secondes. Quelques minutes plus tard, elles sont mortes.
« Pour d’autres espèces, explique Dan Mullen, les animaux sont souvent transportés par camion sur des centaines de kilomètres jusqu’à l’abattoir, et c’est horrible et sanglant. Ce que vous voyez est la forme d’abattage d’animaux d’élevage la moins cruelle. » Le lendemain, nous visitons l’usine de traitement. Des machines y enlèvent la peau de chaque cadavre et la retirent d’un seul tenant, comme un tee-shirt.
New to California? Here's How to Register Your Vehicle: With so many things on your mind after moving to a ne... https://t.co/3dcwQleuJs
— News-insurances Thu Jun 30 09:09:08 +0000 2016
La plus grande maison d’enchères de fourrures du monde est Kopenhagen Fur, au Danemark. Une chaîne constituée de robots, d’appareils de radiographie, de technologie d’imagerie et d’humains offre à la vente 6,8 millions de peaux. Munies d’un code-barres lié à l’éleveur, celles-ci ont été classées en cinquante-deux catégories, et réparties en milliers de lots pour les enchères. Dans la salle des ventes, les acheteurs consultent leurs catalogues, blaguent et manoeuvrent pour obtenir les lots convoités.
Kick est un atelier travaillant pour la Kopenhagen Fur. Là, Ran Fan, une créatrice venue de Beijing, découpe la peau d’un vison couleur lavande. Elle fabrique une sorte de treillis pour une veste légère. « J’adore la fourrure », dit-elle, au diapason de sa clientèle qui raffole des couleurs vives et des modèles insolites. Les consommateurs chinois achètent la moitié de la production mondiale de fourrure.
Le renouveau de la fourrure s’explique en grande partie par sa stratégie de séduction auprès de jeunes créateurs comme Ran Fan et, par ricochet, auprès d’une clientèle jeune. Alors même que les campagnes anti-fourrure battaient leur plein, les grandes salles de vente ont décidé de faire appel à des créateurs et à des étudiants en design. Le but était de contourner les fourreurs traditionnels et les rayons spécialisés pour faire de la fourrure un tissu de qualité comme les autres, disponible partout où sont vendus des vêtements.
Ces relations assidûment cultivées se sont révélées payantes. Les stylistes ont appris à traiter la fourrure de façons que les fourreurs habituels n’avaient jamais imaginées. Grâce aux innovations en matière de teinture, il est possible de produire des fourrures dans n’importe quelle couleur susceptible de faire fureur le temps d’une saison, du bleu aérien au vert flashy. Les nouvelles techniques de couture ont également permis de fabriquer plus de pièces avec moins de matière première. Et la fourrure est devenue plus abordable – un mot jusqu’alors rarement associé avec la pelleterie.
« Cela commence par une jeune consommatrice qui achète un porte-clés en fourrure, explique Julie Maria Iversen, de Kopenhagen Fur. Un peu plus tard, elle s’o rira peut-être un sac en fourrure. Et elle finira par acheter un manteau en fourrure. L’idée est de toucher la prochaine génération de femmes. »
Que penser de ce renouveau ? La prochaine génération de femmes doit-elle se sentir « touchée » ? Ou doit-elle s’indigner, comme l’y encouragent les défenseurs des droits des animaux ? Faut-il se féliciter des progrès de l’industrie des peaux dans le bien-être animal ? Ou ces mesures contribuent-elles à « nous aider à mieux accepter l’exploitation des animaux ? », s’interroge Gary Francione, professeur de droit à l’université Rutgers et partisan de l’arrêt de toute utilisation des animaux par les humains.
Comme le bétail et les volailles d’élevage, les animaux à fourrure passent leur vie en captivité, puis sont tués. Avec des méthodes que peu d’entre nous oseraient imaginer. Par exemple, des éleveurs de renards pratiquent l’électrocution anale, censément plus rapide et e cace.
Beaucoup d’élevages d’animaux à fourrure offrent des conditions décentes à grande échelle; mais de nombreux autres ne le font pas ou ne le veulent pas. Or le processus de tri d’une vente aux enchères fait que les peaux d’un même lot peuvent provenir de 300 élevages différents –bons ou mauvais. C’est un problème pour tout créateur soucieux d’assurer à sa clientèle qu’il respecte des méthodes décentes et durables.
L’industrie de la fourrure européenne affirme qu’elle travaille à une solution –un programme appelé WelFur. Mais sa mise en place suppose au préalable d’inspecter et de noter des milliers d’élevages. Steen Henrik Møller, agronome à l’université d’Aarhus, participe au programme. Je visite avec lui un élevage danois de visons. Son inspection est extrêmement pointilleuse. Møller vérifie les dimensions des nichoirs fixés dans les cages et contrôle la quantité de paille nécessaire pour l’isolation en hiver. Il examine chaque animal, l’état du corps, les blessures et l’existence de mouvements d’avant en arrière, révélateurs de stress. Il introduit un abaisse-langue pour voir si l’animal répond par la peur, l’agressivité ou la curiosité. Une visite du WelFur dure environ six heures pour inspecter un échantillonnage de 120 cages selon 22 critères.
« J’espère que personne ne sera classé dans la pire catégorie, risque l’éleveur.— J’espère bien que si, réplique Steen Henrik Møller, car, si le système ne sait pas faire le tri parmi les éleveurs, il ne fonctionnera pas. »
Pour autant, les acheteurs se sentent-ils vraiment concernés ? « La réponse sera très différente à Shanghai ou à Zurich, reconnaît Tage Pedersen, président de Kopenhagen Fur. Mais, à l’avenir, les consommateurs seront de plus en plus vigilants. Pas seulement pour la fourrure,
mais pour tout ce que nous achetons. Dans une boutique, ils demanderont si le bien-être de l’animal a été respecté. Et si le vendeur est affirmatif, ils diront : “Comment le savez-vous ?” » Pedersen estime que le secteur ne pourra s’offrir un système d’inspection que si les acheteurs acceptent de payer un supplément pour le label WelFur. Sur ce point, il se montre confiant.
Le mouvement de protection des animaux a toujours voulu bannir l’utilisation de la fourrure. La Grande-Bretagne, l’Autriche et la Croatie ont pris des mesures en ce sens ; les Pays-Bas y travaillent. Mais une interdiction n’empêche pas les gens de porter de la fourrure. La production se délocalise là où cette interdiction ne s’applique pas. Pendant la vente de Kopenhagen Fur, j’ai demandé à un courtier, propriétaire d’un élevage de visons en Chine, si ce pays avait progressé en matière de bien-être animal. L’homme s’est crispé, avant de lancer sèchement : « Pas beaucoup. »
Interdire l’élevage des animaux à fourrure ne change rien non plus à l’élevage du bétail. C’est s’offrir une bonne conscience à peu de frais. La majorité d’entre nous n’a jamais acheté de fourrure et n’en achètera jamais, et pourtant mange de la viande, boit du lait, porte des chaussures en cuir et participe aux formes d’exploitation animale que les humains ont toujours pratiquées – à une échelle qui, en comparaison, rend l’industrie de la fourrure marginale.
Les acteurs du secteur se plaisent à fustiger l’hypocrisie ambiante. Presque tous observent que les autres éleveurs n’ont pas dû améliorer leurs pratiques aussi systématiquement qu’eux. « Nous savions que nous risquions l’interdiction, rappelle Tage Pedersen. Les autres éleveurs n’avaient rien à craindre de ce côté-là. »
Alors, voici mon idée : au lieu d’interdire la production de fourrures, continuons de faire pression pour empêcher les mauvais éleveurs de nuire. Ensuite, prenons les éleveurs les plus progressistes et les améliorations (généralisables, parfois aussi rentables) qu’ils ont apportées : confinement des ruissellements agricoles, réduction du stress, meilleur logement pour les animaux, inspections régulières pour vérifier leur bien-être. Et faisons en sorte que ces progrès deviennent le modèle de toutes les formes de production animale dont dépendent nos vies, pour lesquelles nous avons tant d’égard.