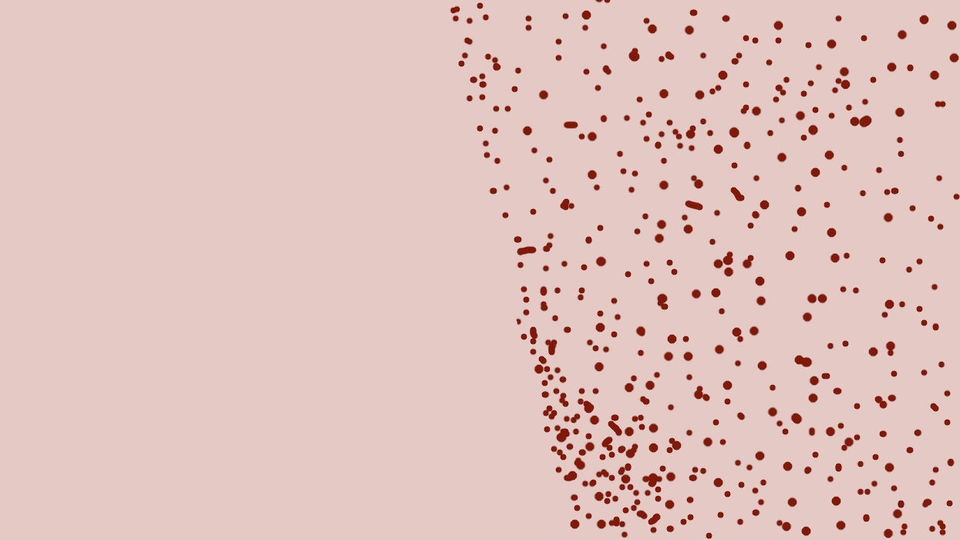BALLAST • Déborder le désespoir
29 janvier 2022Une nouvelle année vient donc de commencer. Et c’est sous le signe du désespoir que l’écrivain et dramaturge Arnaud Maïsetti — auteur, notamment, des ouvrages Bernard-Marie Koltès et Saint-Just & des poussières — la place : l’absence d’espoir, ordinaire et largement partagée, face au monde comme il file. Mais il ne saurait être ici question de lamentation : le texte, dont son rédacteur se réclame de l’émancipation communiste, convie la lutte, la colère et la destruction. Nouvelle année, et nouvelle rubrique : l’écrivain s’est saisi à sa guise de cette première « Carte blanche ».
Partir du désespoir. Janvier.
Que le monde soit là, tout rassemblé sur lui-même et s’adressant des vœux pour l’année nouvelle dit déjà quelque chose de la désespérance : où tout se poursuit à l’identique, rien ne peut avoir lieu de neuf.
Du désespoir, au moins, tirer les forces pour ne pas s’en tenir là. La puissance de la lamentation nous arrache à l’effarement, l’illusion que tout ira bien — quand tout complote pourtant, chaque jour de chaque nuit, pour maintenir en l’état le monde, le monde, c’est-à-dire l’autre mot pour dire la guerre en cours contre nous.
C’est le premier mouvement, comme d’une fugue ; la levée : mouvement de dégagement, et que salubre soit le vent. Refuser tout en bloc de ce qui commence au nom de ce qui continue : la domination sur les corps et les imaginaires, sur les délires, les raisons d’être, les histoires et leurs devenirs. Le premier mouvement est de désespoir et il ne sauve ni ne console, mais donne l’appui.
Se défaire de toute espérance pour mieux terrasser en soi le goût des arrières-mondes comme des lointains rédempteurs : ne pas se confier aux règnes des fins au nom de ce qui se trame, là, maintenant, œuvré dans les fatalités et les compromis, d’implacable à terrasser d’abord. C’est une des ruses les plus sournoises de l’époque : nous confier le soin de rêver aux délices de la catastrophe, de l’espérer même, et avec un peu de chance, elle en finirait pour de bon avec l’époque et son désastre — et en attendant, attendre ? Non, le désastre est avant tout celui dans lequel nous sommes liés, pieds et poings, et qu’à regarder aux horizons, on oublierait que le chemin est tracé de notre ombre. La catastrophe ne nous sauvera pas de maintenant ; plutôt signe-t-elle notre appartenance à elle ; et qu’il n’est pas de salut, désormais ni jamais ; que toute pensée du salut nous lie à la faute, et toute faute nous condamne à expier celles que nous n’avons pas commises. Refuser les arrières-mondes et les après enchanteurs, oui, pour mieux insulter le salut qui nous rachèterait de nous-mêmes des fautes qu’on nous inflige.
Le présent n’attend pas pour avoir lieu. L’urgence n’est pas à l’après : il est à l’épaule contre épaule, à ce pied à pied sur chaque instant. La catastrophe a déjà eu lieu, et l’urgence est à la précipiter, encore et encore, moins pour sauver, que pour s’arracher d’elle.
Se confier ainsi aux forces de la destruction — maintenant plus que jamais.
Mais puisque la domination sait mettre les formes pour s’imposer, voilà qu’elle entre dans cette période où elle s’agite pour élaborer ses programmes, qui sont d’autres vœux plus répugnants encore. Voilà des propositions qui noircissent le tableau. Et nous, que proposerons-nous de sincère et de puissant, qui ne servirait pas la domination ? Toute proposition capable d’être acceptée par ce monde serait par nature complice de son forfait. Puis, quoi ? Se glisser dans la peau des dominants n’a rien de désirable, à partager leurs cas de conscience et leurs doutes raisonnables, dire ce qu’il en serait du monde si on le faisait autre. Ce rêve aussi, en l’état, est allié de la domination.
Ne rien proposer, non, rien : se tenir, comme porte battante, dans ce qui ne fait que passer et fait passer.

Bien sûr le piège, on le sait, on le sent, celui du confort de se lover, à l’abri de tout, dans ce refus intact. Qu’au refus soient associés la fuite et l’oubli — que ce qui demeure intact avant tout est ce qui entoure et enserre. Qu’à force de négations, nous voilà aussi, et plus encore peut-être, alliés et complices de ce monde. De bord en bord, nous voilà donc désespérément cernés.
Dans l’incertain, ce qui piège surtout et se referme sur nous est la pauvreté du langage où on le maintient. Ces mots de destruction ; ces mots d’affirmation. Guerre au langage ici encore, guerre à ce qui nous fait guerre, autour et en nous — ne rien pacifier de ce qui nous tue.
Le désordre véritable — celui qui met en pièce et rend impossible ce qui unit les êtres entre eux ou les ouvre à autre chose qu’eux-mêmes — vient de ce monde et c’est là son théorème. Face à lui, seul un désordre plus grand capable de dévisager son scandale pourrait le défaire : désordre contre désordre, deux mots pour deux réalités retournées l’une contre l’autre : lever face aux désordres de la domination le désordre aimanté par d’autres conjurations, son dégoût et le désir d’autres liens qui ne soient pas aux poings et dans les crânes.
Détruire ce qui dans le mot de destruction désigne seulement ce qui fait le vide : penser le plein dans le délié des formes et que ces forces agissent. Détruire, c’est aussi faire la place et que se dresse dans la plénitude à venir la possibilité d’autres puissances. Oui, détruire serait défaire maille à maille, et en soi, ce qui nous détruit : la langue raciste que l’on parle, la langue dominée qui nous parle, la langue de toujours qui nous saisit au collet à chaque mot. « Mener campagne contre toi-même » : Nietzsche ne parlait pas là de campagne électorale.
La révolte prend de vitesse. C’est sa seule allure. Parler au-delà de soi, au-delà du langage — seul usage possible de la langue si on veut en faire une arme, et qu’on appelle cela lyrisme, tant pis, pourvu que ce soit ce débord et cet outrage.
Partir du désespoir, et le déborder. La lamentation n’a de sens que si elle se marmonne, entre les dents, les poings fermés, et que le dieu l’entende, et qu’il prenne peur.
Où prendre appui, dans le désespoir ?
Si ce monde est un grand charnier, qu’il ne le soit pas seulement dans la beauté terrible de l’image. Chaque semaine depuis des mois, on découvre, dans les établissements catholiques du Canada, un nouveau massacre d’autochtones ; il n’a pas suffi de les massacrer d’abord et leur transmettre toutes nos maladies, leur voler leurs terres ensuite, ou les convertir — tout cela qui est une seule et même chose, un seul et même programme d’accomplissement du monde et de sa réalisation effective partout et sur tous —, non, il a fallu violer et enterrer les cadavres sur des générations au lieu même des pensionnats où se donnaient la leçon et l’hostie. Oui, si ce monde est bâti sur un cimetière sioux ou cri, comme dans les vieux romans d’épouvante où reviennent se venger les massacrés eux-mêmes, c’est là-bas peut-être qu’est l’axe de notre époque. Dans ces territoires du nord, qu’on dit réserve se joue le massacre et ce qui pourrait le dévisager, la vengeance politique, autre nom de la révolution à venir. Réserve : chaque mot pour désigner chaque chose est une insulte, et d’abord les mots de « Sioux » et de « Cri », on le sait, qui désignent dans notre langue un peuple par l’insulte accordée à ses ennemis — alors c’est dans le langage que pourrait se jouer la contre-menée.
NDN. Dans la langue de certains poètes autochtones du Canada, c’est le terme utilisé pour se désigner. À prononcer intérieurement ces lettres liées, on retrouverait le mot insultant en anglais, celui qu’on ne dit qu’en charriant les cadavres — et le projet civilisateur au nom de quoi ce mot était lâché. Déposé ainsi, NDN, forgé depuis l’insulte, mais marmonné par l’écrit, dans le texte scellé comme dans la colère des lamentations, celles prêtes à se jeter sur le visage, le mot témoigne dignement des saccages et du désir de ne jamais désemparer. Ceux qui ont fait Indiens les êtres qui ne l’étaient pas, mais par là les assignaient à ce mot et à ce qu’il recouvrait sous la sauvagerie à domestiquer ne savaient pas qu’ils donnaient aussi la possibilité de forger une autre arme : qu’avec ce mot, ils désignaient aussi les forces capables de leur être opposées.
À ce point localisé dans le monde existent de telles forces — elles ne peuvent servir qu’à ceux pour qui elles se destinent, au nom de la malédiction qui a pris corps dans le langage des dominants pour se poser, comme une couverture emplie de typhus, sur la peau des Premières Nations. Mais il reviendrait à chacun de trouver de telles armes, forgées d’identique manière, puisque les insultes sont légions qui ont servi à chaque instant à bâtir ce monde en le nommant, le désignant sauvage pour justifier de le domestiquer.
Voici donc, par exemple, NDN, une des formes données du désespoir. Elles logent dans un mot qui l’est davantage. Le désespoir travaille ainsi les intelligences collectives qui produisent nos contre-mondes, déposés non pas après, dans les horizons lointains des émancipations acquises, mais là, au-dedans de l’aliénation même, au cœur des choses mortes, sous la terre des pensionnats autochtones où reposent la poussière et la cendre d’enfants assassinés qui ne savaient pas dire leur nom dans leur langue et qui priaient dieu qu’on leur pardonne d’être massacrés.
De lutter, on éprouve la continuité du vivant en nous, et, de lutte en lutte, la solidarité active des êtres à son passage. C’est que la lutte ne produit pas seulement sa lutte, elle en rend possible d’autres après elle, élaborant à l’instant le récit de sa levée, somme d’expériences dont nous sommes tout à la fois issus et tissés. Elle dit ce qu’il en est du monde face à laquelle elle se dresse ; elle dit que cela suffit ; elle dit que, ici et maintenant, quelque chose s’arrête de ce monde-là et en trace les bornes ; elle arrête la marche forcée de ce qui vide le ciel et remplit la terre de cadavres. Lutter nomme la façon d’habiter autrement le temps, face à quoi le monde n’est plus qu’une manière parmi d’autres, plus écœurante que d’autres, de massacrer des enfants Sioux dans un pensionnat chrétien.
Le désespoir ne peut être que ce point de départ par quoi tout peut être de nouveau nôtre : et d’abord ce monde, et d’abord ce langage, et d’abord ces désirs qui fondent l’un et l’autre. Mais ce n’est pas par désir que le désespoir s’impose : bien plutôt par nécessité et froideur, quand on regarde, méthodiquement, ce qu’il en est de ce qui est, qu’on en dégage les logiques à l’œuvre, qu’on s’obstine à comprendre comment la domination s’exerce et où (partout) — et qu’elle est la seule loi de cette réalité qui la nomme.
S’obstiner à regarder le monde exige de s’en défaire, d’en défaire ce qui le rend possible.
Et ce qui le trame de part en part tient à l’imaginaire qui le creuse et le soutient : on ne fait pas la guerre à ce monde sans porter les armes contre cet imaginaire-là armé de pied en cap de mots morts et d’images stériles qui ne cessent plus de dessiner sur la paroi le long film en continu de notre appartenance. On n’a pas à apporter de propositions d’améliorations à ce réel : seulement lui opposer un autre fait de ce qu’il n’est pas — non pas le retourner comme un gant, mais agencer d’autres rapports où le langage lui-même ne servirait pas à ce qu’il sert, ici.
« Découper dans l’effarante réalité des formes capables d’en désigner l’effroi » (Olivier Neveux) — tâche de l’art, d’un certain art quand il n’est pas lâche et veule (autant dire : rarement et par soubresauts inquiets). Il n’en a pas le privilège. Dans la guerre en cours qui se mène, désigner l’effroi de ce monde est de salubrité publique autant que d’appeler à d’autres manières de vivre : lever l’abjection de maintenant pour soulever le désir d’ailleurs est peut-être un même geste ; nommer le désir au nom du manque tient du même mouvement de soulèvement.
Hospitalité du désespoir qui encourage, sait faire venir à lui les quatre vents pour les éparpiller. Il y a des pièges ; le désespoir sait combien il n’a pas de fermeté par lui-même, qu’il est ce balancement bancal entre fragilité et férocité, entre certitudes et abandons, entre dérisions et gravité. Il n’a pour lui que l’obstination à ne pas être indifférent, et le désir de chercher partout des peines qui le chargeront davantage pour mieux nourrir sa vitalité. Il ne cherche jamais très loin. Où qu’il regarde, la peine est là, large et terrible. Hospitalité du désespoir quand il faut nommer la peine et lui donner forme.
Elle prend corps ici et là, dans quelques colères dignes, dans quelques livres qui donnent plus rageusement le désir de vivre loin des livres.
Aimer fait cela, aussi. L’amour n’est pas la moindre des contre-manières de vivre, des complots insidieux ; des puissances qui soulèvent. Aimer non plus n’est pas sans piège, sans malentendu, ni délire — sauf qu’aimer tient tout entier du malentendu et du délire.
Il y a toutes les raisons de désespérer, qui rendront caduques les raisons de ne plus désespérer.
Partir du désespoir et, de là, tout droit dans la colère, chercher sans attendre à ne pas arriver quelque part pourvu que ce ne soit pas ici. Tenir le pas gagné.
Publié le 29 janvier 2022dans LittératureparArnaud Maïsetti