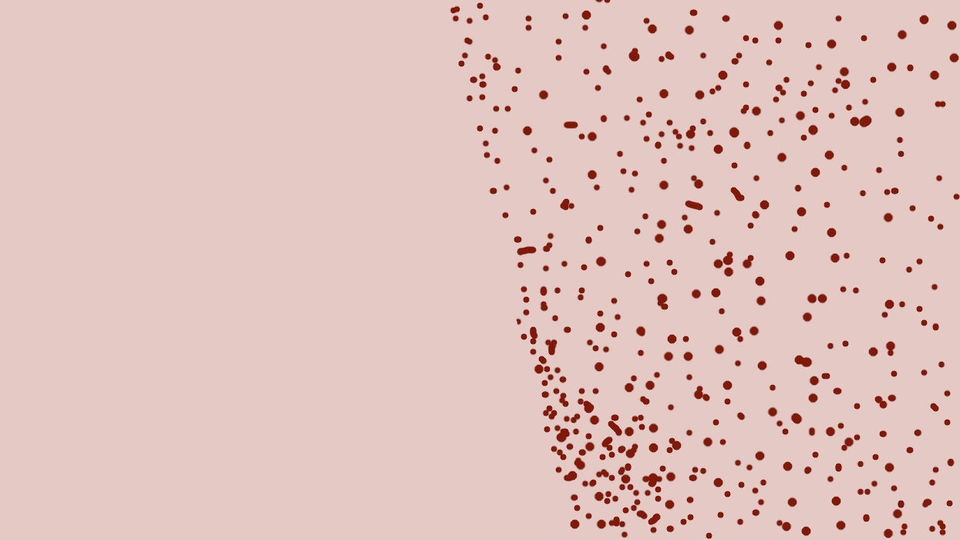Migrants climatiques, des Péruviens refont leur vie dans le désert
Région de Piura (Pérou), reportage
Pour rendre visite aux déplacés climatiques depuis Piura, à l’extrême nord du Pérou, il faut d’abord rejoindre la Panaméricaine nord. Le long de cette route se trouvent plusieurs regroupements. L’un d’eux est communément appelé « le kilomètre 980 » car son accès est à ce niveau. Une demi-heure de taxi et une dizaine de minutes à pied plus tard, sur un chemin où se croisent motos-taxis et charrettes, les premières habitations se dessinent au milieu d’un paysage fait de sable et d’arbustes. Dans ce décor désertique, environ deux mille familles vivent dans des constructions précaires faites de paille, plaques de bois et autres matériaux peu coûteux au sein de huit « villages ».
- © Gaëlle Sutton/Reporterre
La raison de l’exil ? En mars 2017, le phénomène climatique El Niño, courant marin saisonnier dans le Pacifique sud, a entraîné des pluies intenses provoquant le débordement du fleuve Piura et des inondations dévastatrices. Au total, 300 000 personnes ont été déplacées dans le pays de 33 millions d’habitants, selon l’Organisation internationale des migrations. José Juan Morales habitait sur les bords du fleuve. Debout à l’entrée de sa cabane — il vient de rentrer de sa parcelle en compagnie de sa jument, Berta — il se souvient du jour où il est arrivé ici : « Les forces armées nous ont évacués avec des hélicoptères. » Sa voix se coupe. Les larmes lui montent aux yeux. Il reprend : « Il y a eu des morts. Nos animaux, tout ce qu’on avait, nos maisons, tout a été emporté. On a tout perdu. On était encerclé par les eaux. Ils nous ont évacués dans cette zone. » L’homme de 68 ans vit désormais à une vingtaine de kilomètres de ces rives. Selon un rapport de l’Institut national de défense civile (Indeci) de 2017, au moins 138 personnes sont mortes à travers le pays.
- Environ deux mille familles vivent dans des constructions de bois, de paille et de tôle. © Lysandra Chadefaux/Reporterre
Sur les hauteurs du kilomètre 980, Lucy Santoval Zapata élève cochons et chevaux. L’agriculture est l’activité principale de la plupart des habitants. Le quotidien s’organise autour de la culture du maïs, du coton, des haricots et de l’élevage des animaux — qu’ils mangent et vendent. Sans eau courante ni électricité depuis leur arrivée, les journées se font au rythme du soleil. « À partir de 18 heures, la nuit tombe. On se retrouve plongé dans le noir, donc nous allons nous coucher. On allume une bougie. Quand elle s’éteint, il est l’heure de dormir. Nous, ce que nous voudrions, c’est de l’électricité et de l’eau, surtout pour nos enfants », dit la mère de six enfants. L’eau est apportée par camion-citerne deux fois par semaine. « Nous en manquons. Elle représente tout pour nous. Nos animaux en ont autant besoin que nous. » Lucy ajoute qu’aucun système d’égouts n’existe et évoque la présence de serpents et d’insectes dangereux.
« Il n’y avait rien ici, juste quelques arbres et des étendues arides à perte de vue. On a tout bâti à la sueur de notre front », dit à Reporterre Ernesto, le mari de Lucy. Au départ, cette zone était un campement de secours mis en place par les autorités. Les déplacés vivaient sous des tentes. Une partie est depuis retournée près du fleuve car les services de base y sont assurés. Pas Ernesto. Il ne veut pas risquer de tout perdre à nouveau. « Tous ceux qui sont restés ont fini par s’habituer à ce lieu. On est mieux ici car on ne vit pas avec la peur d’une nouvelle inondation. » Si le débordement du fleuve Piura s’est déjà produit par le passé, notamment en 1983 et 1998, les El Niño extrêmes — et leur pendant, le phénomène La Niña — seront plus fréquents sous l’effet d’un réchauffement climatique non contrôlé [1].

Malgré les difficultés, le campement se structure peu à peu. Il n’y a pas de marché alors un vendeur de poisson frais s’installe tous les jours au même carrefour. Il vend ses produits depuis le coffre d’une vieille Toyota Caldina grise « presque prête pour la casse », selon une cliente qui plaisante en attendant sa commande. Quelques rues plus haut, Araceli Chiroque, 36 ans, vient tout juste d’ouvrir son « petit magasin ». Gâteaux et aliments de première nécessité sont suspendus le long d’un fil pour la vente.
- José Juan Morales vivait sur les rives du fleuve Piura avant son débordement en 2017. © Lysandra Chadefaux/Reporterre
Dans les cabanes, la majorité des affaires est placée en hauteur afin de ne pas être en contact avec le sable du sol. Entre mobilier de récupération et aménagement sommaire, chacun fait comme il peut pour arranger son logement. « Petit à petit, on se transforme en village. On se sent fiers de voir le résultat de nos efforts. » La mère de quatre enfants travaille, comme une partie des habitants, pour des entreprises de raisins situées aux alentours en tant que saisonnière. Araceli se dit optimiste : « Maintenant, je vais travailler l’esprit apaisé car mes enfants ont un toit sur la tête. »
Jorge Nizama Chiroque, 25 ans, arrondit ses fins de mois en faisant moto-taxi. « Quand il y n’a pas de travail saisonnier, il faut trouver d’autres sources de revenus », résume-t-il. Une journée de moto-taxi rapporte 25 soles (5 euros). « Ce serait difficile de vivre toute l’année uniquement de cette activité. » Sans route, les moteurs des machines souffrent. Il n’est pas rare de croiser une moto-taxi en panne. En dehors des problèmes communs à l’ensemble de la population, Jorge décrit le quotidien dans cette zone comme « tranquille ». Il a installé à l’arrière du véhicule deux enceintes. « C’est pour mes clients, je mets de la cumbia ou de la salsa. »
Abandonnés par l’État
« Bonjour, à vendre : poulet dans la maison de Marie Carmen, rue du 1ᵉʳ mai. » La voix de Greysi Dallana Namuche Cahuana, 11 ans, résonne à travers les huit villages que compte le kilomètre 980. Elle lit et diffuse grâce à un haut-parleur des petites annonces. « Cela informe la population quand il y a des réunions, pour savoir quand aller se faire vacciner ou qui vend quoi. C’est important car cela aide les habitants. » À cause de la pandémie de Covid-19 et comme l’ensemble des enfants au Pérou, Greysi suit ses cours à la maison. Cela se passe sur son téléphone portable. « Ce n’est pas facile parce qu’il n’y a pas internet ici et pas beaucoup de signal. » Le manque d’électricité complexifie le suivi des cours. Toutes les familles n’ont notamment pas les moyens d’acheter des panneaux solaires afin de recharger les téléphones.
- Araceli Chiroque et deux de ses enfants devant leur cabane. © Lysandra Chadefaux/Reporterre
Le père de Greysi, Leopoldo, est le « président » de Nuevo Santa Rosa. Chaque nouveau village a désigné un représentant afin de s’organiser. L’homme sort un document officiel attestant qu’il fait partie des « personnes déplacées par les désastres naturels causés par El Niño costero 2017 ». Leopoldo se sent abandonné par l’État : « Cela fait presque cinq ans maintenant. On a besoin d’eau, encore plus avec la pandémie, et de services hygiéniques. Il y a le problème de la nutrition des enfants. Celui des mouches et du sable dans la nourriture. On veut être entendu. Nous sommes des déplacés, nous avons des droits. » En cas de besoin médical, il faut compter vingt à trente minutes de trajet pour accéder au centre de santé le plus proche. Autre couac, les terres n’appartiennent pas aux habitants. Selon eux, elles appartenaient jadis à leur communauté : ils aimeraient donc trouver un accord pour en redevenir propriétaires.
- Des produits frais sont vendus depuis une Toyota tous les matins. © Lysandra Chadefaux/Reporterre
« La solidarité est une habitude ici »
En ce dimanche midi, plusieurs voisins s’affairent à la préparation d’un repas. Il s’agit d’un événement organisé afin de récolter des fonds pour un habitant malade. Installés à des tables, les résidents dégustent leur plat et boivent leur chicha de jora, une boisson à base de maïs. Sur fond musical, Luis Pasache Silva, un habitant, anime l’événement. « La solidarité est une habitude ici. On est toujours disposé à venir en aide dès qu’une personne en a besoin », souligne-t-il entre deux dédicaces au micro.
Plus bas, Eduardo Rodriguez Prado, aidé par son fils Eduardo junior, pose les premières briques de sa maison. « Entre les fortes chaleurs, le sable et le froid, les températures sont extrêmes ici », dit l’homme, qui espère pouvoir prochainement offrir à sa famille un logement fait de matériaux plus solides.
- Le fleuve Piura se situe à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest. © Lysandra Chadefaux/Reporterre
La nuit est tombée. Dans la partie salle à manger de la cabane de Gladys et Victor, une télévision diffuse un dessin animé. La scène est quasi inédite, très peu d’habitations du kilomètre 980 ont la télévision. « On a les enfants du voisinage chez nous le soir. Comme ça eux aussi en profitent. » Victor explique que l’effort financier a été « lourd » pour acheter les panneaux solaires mais qu’il veut assurer un peu de confort à ses enfants. « C’est maintenant eux le futur. » Une voisine rejoint le groupe désormais assis autour d’un bac rempli de maïs. « C’est notre divertissement à nous, on discute en égrenant du maïs, la journée s’achève ainsi. » Les tiges restantes sont soigneusement mises de côté. Elles serviront demain à allumer le feu pour préparer le petit-déjeuner.
📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info
Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre.
S’abonner