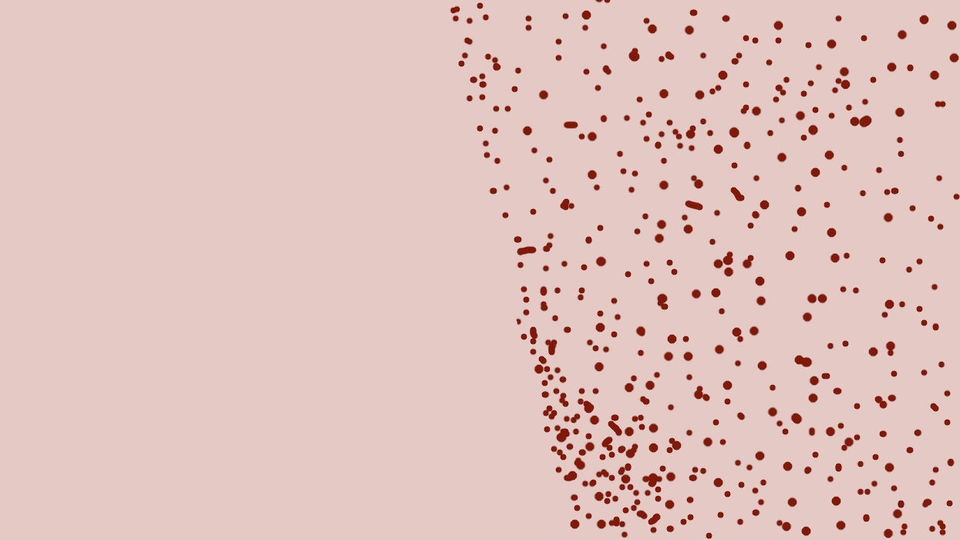Un autre scrutin présidentiel. Élire le chef de l’État au suffrage indirect en Europe
Un autre scrutin présidentiel. Élire le chef de l’État au suffrage indirect en Europe, Montrouge, éditions du Bourg, 2020, 202 p.
Sous la direction de Fabien Conord (Université Clermont Auvergne)
À l’aube de la campagne présidentielle française, il ne paraît pas inutile de rappeler que le président de la République n’a pas toujours été élu au suffrage universel direct, sous la Ve République. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, alors que la IVe République n’est pas encore née, le Général de Gaulle dessine, dans un discours à Bayeux le 16 juin 1946, les traits de ce que sera douze ans plus tard notre actuelle Constitution. Il prend alors soin de préciser que « le pouvoir exécutif ne saurait procéder [du Parlement] », ajoutant que « c’est […] du chef de l’État […] élu par un collège qui englobe le Parlement mais beaucoup plus large […] que doit procéder le pouvoir exécutif ». En 1958, « le Président de la République est élu […] par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des Territoires d’Outre-Mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux » (article 6, al. 1 C). Les parlementaires représentent moins de 1 % du collège électoral. La rupture avec les régimes précédents est consommée au nom de la séparation effective des pouvoirs imposée par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Michel Debré justifie devant le Conseil d’État, le 27 août 1958, les raisons de ce choix éloigné en apparence de la verticalité du pouvoir présidentiel. Le poids de l’Outre-mer, notamment de l’Algérie, et le risque de voir les communistes très influents arbitrer l’élection présidentielle conduisent à la prudence.
Partant des origines de la IIIe République, cette histoire est retracée par l’ouvrage dirigé par Fabien Conord : Un autre scrutin présidentiel. Élire le chef de l’État au suffrage indirect en Europe. Publié en 2020, il est le fruit d’un colloque organisé à Vichy les 28 et 29 novembre 2019. Faisant dialoguer historiens et juristes publicistes, au travers de douze contributions, cette étude analyse les règles, dynamiques et conséquences de l’élection au suffrage indirect du chef de l’État en France et aussi à l’étranger. La longue expérience de la IIIe République justifie que cinq textes s’y consacrent, sans que soient oubliés la IVe et le début de la Ve Républiques. Suivent des réflexions politico-partisanes et un volet comparatiste. Fabien Conord rappelle à ce sujet que hors l’hypothèse d’une monarchie parlementaire, le chef de l’État, en Europe et au-delà, est le plus souvent élu au suffrage indirect. Ce mode de scrutin n’enlève rien à l’autorité présidentielle, voire à l’autoritarisme (Cuba, Chine, Corée du Nord, Vietnam). L’élection directe ne correspond pas davantage au présidentialisme « à la française ». Si, dans treize États membres de l’Union européenne, le président est élu au suffrage direct, ses attributions demeurent celles du chef d’État d’un régime parlementaire classique où la réalité du pouvoir se concentre surtout entre les mains du Premier ministre. Fabien Conord remarque en outre que le nombre de femmes élues indirectement à la magistrature suprême a sensiblement augmenté depuis les années 1980, mais leurs pouvoirs limités en font « mutatis mutandis, des formes modernes de Marianne ».
Sous la IIIe République, le président est élu par les deux chambres du Parlement réunies en « Assemblée nationale », bientôt surnommée « Congrès » en raison du nombre de parlementaires présents. Le grand hémicycle – construit au sein du Château de Versailles en 1875 pour accueillir la Chambre des députés avant le transfert des pouvoirs publics à Paris en 1879 – s’impose comme siège du Congrès où seront élus les quatorze présidents de la IIIe République. S’installe alors le rituel d’une transhumance minutée entre la capitale et la résidence des rois de France. Le téléphone arrive en 1899 et en 1906 le réseau télégraphique du Congrès permet d’envoyer 450 000 mots par heure. Une multitude d’anecdotes dévoilent les coulisses de ce grand rendez-vous démocratique. La séance du Congrès est régulièrement émaillée de « Vive le Roi ! » lancés par des parlementaires de droite. Le lieu n’y est sans doute pas étranger. En 1913, viennent toutefois des rangs de la gauche des « Vive la Commune ! » : « On crie donc beaucoup à Versailles, mais sans que ces exclamations ne troublent vraiment le bon ordonnancement du scrutin » (Arnaud-Dominique Houte).
La presse suit au plus près l’évènement. L’élection présidentielle est alors l’occasion de comprendre dans les colonnes de La Croix la relation complexe entre la République et l’Église. En 1887, préoccupé par la candidature de l’anticlérical Jules Ferry, le journal catholique ne voit pas venir celle de Sadi Carnot. Se livrant au jeu des pronostics comme ses confrères, il dénonce la vanité du Congrès comparé à « une volée de feuilles mortes qui ne savent pas où elles vont, ni ce qu’elles font ». Dénonçant une classe politique laïcisée, il s’interroge lors du Congrès du 28 juin 1894 : « Combien seulement ont entendu la messe ? ». La Croix dénonce plus largement « le suffrage universel, le parlementarisme, et par-dessus tout l’influence des loges maçonniques et les lois laïcisatrices qui coup[ent] la France de Dieu » (Jacqueline Lalouette). Pour les socialistes, hostiles au principe de l’élection présidentielle, la perspective d’une victoire de Jules Ferry conduirait, selon Le Cri du Peuple, à une nouvelle Commune.
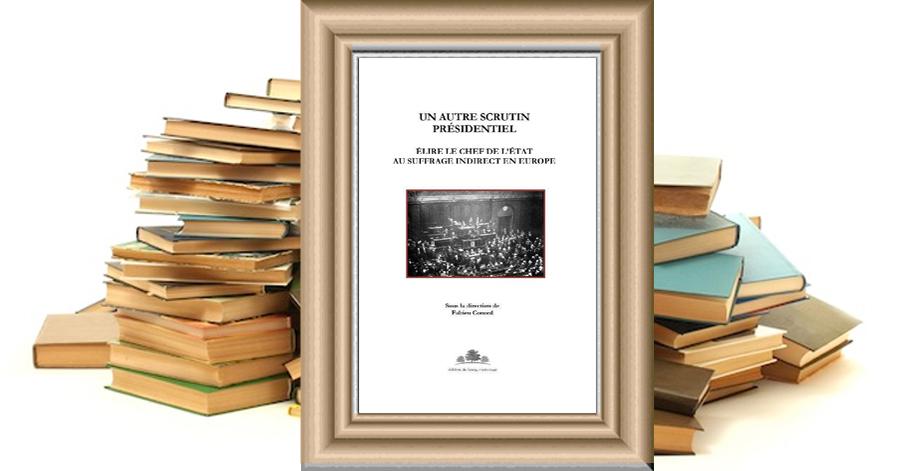
En décembre 1895, emmené par Jaurès, Guesde et Vaillant, le groupe socialiste à la Chambre des députés demande l’abolition de la présidence de la République. Il faut attendre 1913 pour voir, avec Édouard Vaillant, une première candidature socialiste qui « constitue en fait un nouvel avatar de la dégradation des rapports entre socialistes et radicaux » (Gilles Candar). Aucun candidat socialiste ne sera en mesure de l’emporter. Inaugurées en 1924, les candidatures communistes, destinées à mieux affirmer le rejet de la République, suivent le même chemin. Avec le Front populaire, le PCF s’implante durablement dans le paysage politique français. « Le parti communiste rencontre véritablement la nation française au cours de cette période 1934-1938 » (Jean Vigreux), sans pour autant peser sur la dernière élection présidentielle de la IIIe République en 1939. Incarnant, après-guerre, le parti de la Résistance, il connaît son apogée sous la IVe République jusqu’au début de la Ve République. Représentant 25 % de l’électorat en 1958, il constitue une menace écartée par le pouvoir constituant qui se résout à la formule de l’élection présidentielle au suffrage indirect.
Politiquement, après les premières élections présidentielles tenues suivant un mode relativement consensuel au début de la IIIe République, celle de 1887 inaugure une nouvelle ère plus concurrentielle. Impliquant Daniel Wilson, gendre du président, l’affaire des décorations pousse Jules Grévy à la démission. Figure des Républicains modérés, Jules Ferry est vu un temps favori pour lui succéder. Cependant, la droite se divise à son sujet après qu’une partie des royalistes s’aventure dans une obscure manœuvre pour le forcer, sans succès, à se marier religieusement dans le discret salon d’un appartement parisien. De la gauche guesdiste à Ligue des Patriotes de Paul Déroulède, en passant par les boulangistes, les adversaires de Ferry sont en réalité nombreux. Poussé par les radicaux, Sadi Carnot se présente faute de mieux face à lui. Dominé, Ferry se désiste à l’issue du premier tour. Carnot l’emporte logiquement au deuxième tour de scrutin. Au-delà des querelles partisanes, sa victoire est surtout l’échec de Ferry : « la IIIe République ne veut pas d’homme d’État à l’Élysée » (Bertrand Joly).
L’année 1920 est marquée par deux élections présidentielles. Seul candidat après le retrait de Georges Clemenceau, le 17 janvier, avec 84,6 % des voix, Paul Deschanel devient le président le mieux élu de la IIIe République. Clemenceau aurait pu gagner, mais, légèrement devancé lors d’un vote préliminaire à la réunion du Congrès (408 voix pour Deschanel ; 389 pour Clemenceau), il se retire, déclarant ne pas vouloir « [essayer] de gouverner contre une majorité ». De santé fragile et victime de surmenage, Deschanel chute d’un train dans la nuit du 23 mai et démissionne le 17 septembre. Soutenu par le Bloc national dont il fut l’artisan, le président du Conseil sortant, Alexandre Millerand, est élu le 20 septembre avec 695 voix face au socialiste Gustave Delory. Fort de l’exercice du pouvoir à la Présidence du Conseil, il tente en vain de restaurer l’autorité présidentielle. La défaite du Bloc national aux législatives de mai 1924 le prive de soutien parlementaire. Ayant activement défendu son camp pendant la campagne, il a rompu avec la tradition d’une certaine neutralité issue de la Constitution Grévy (élu président de la République en 1879 après la démission de Mac-Mahon, Jules Grévy avait déclaré ne pas vouloir entraver l’action du Parlement). Victorieux, le Cartel des Gauches le pousse à la démission le 11 juin. « [L]a double élection présidentielle de 1920 met en regard deux conceptions du rôle du Président » (Fabienne Bock). L’effacement hérité de la crise du 16 mai 1877 ne pouvait finalement que l’emporter. Pourtant, le Cartel des Gauches ne réussit pas à imposer son candidat, Paul Painlevé, tout juste élu président de la Chambre des députés. Gaston Doumergue, président radical du Sénat et donc issu de la gauche non cartelliste, est élu le 13 juin 1924 avec l’appui d’une partie de la droite. Les causes de la victoire de Doumergue sont semblables à celle de la démission de Millerand. « Painlevé, comme Millerand avant lui, aurait en somme été considéré comme un Président trop engagé dans les luttes politiques, du côté du Cartel cette fois » (Jean-Étienne Dubois).
Alors que la IVe République perpétue la tradition de l’élection présidentielle par le Parlement, celle de 1953 vient perturber ce qui était devenu une routine. L’expérience forgée par la pratique conduisait la plupart du temps à décider du nom du vainqueur avant le vote formel. Le 16 janvier 1947, Vincent Auriol avait été élu dès le premier tour de scrutin. Entre le 17 et le 23 décembre 1953, René Coty sera, au bout du treizième tour de scrutin, le président le plus mal élu de l’histoire de la République. La loi sur les apparentements du 7 mai 1951 avait transformé l’Assemblée nationale en chambre « hexagonale » car divisée en six partis de poids comparables. En 1953, le Congrès se partage donc entre le PCF (116 sièges), la SFIO (161), le RGR (171), le MRP (115), le CNIP (221), et les Gaullistes (126). S’y ajoutent les Indépendants d’Outre-mer (27) et les non inscrits (9). Le paysage est d’autant plus morcelé que ces formations sont parfois le fruit d’attelages politiques hétéroclites, à l’image du RGR composé des Radicaux d’avant-guerre, de l’UDSR issue de la résistance, et quelques partis venus de la droite. Marcel-Edmond Naegelen (SFIO) et les différents candidats du CNIP arrivent en tête à chaque tour de scrutin. Alors qu’il n’était pas candidat, René Coty (CNIP) recueille 71 voix au onzième tour avant d’être élu au treizième (477 voix). « [C]ofondateur du CNIP […], parlementaire respecté, […] maréchaliste qui avait pris ses distances avec Vichy en 1943, catholique pratiquant, républicain modéré et européiste convaincu, [René Coty] offrait les garanties que les intérêts du [CNIP] seraient toujours pris en compte à la tête de l’État » (Gilles Richard).
Au début de la Ve République, l’élection présidentielle de 1958 s’apparente à un OVNI constitutionnel. Certes, le président de la République est élu au suffrage universel indirect, mais par un collège électoral inspiré de celui du Sénat où le Parlement est insignifiant. De Gaulle promet la stabilité gouvernementale et la résolution de la crise algérienne. Lors du référendum du 28 septembre 1958, le « Oui » à la Constitution atteint 79,25 % des voix. Face à deux candidats dépourvus d’envergure (le communiste Georges Marrane et Albert Châtelet de l’UFD, formation marginale de gauche très hostile à la Ve République), il est de fait favori. « La seule inconnue de l’élection du 21 décembre reste l’ampleur de la victoire » (Bernard Lachaise). De Gaulle est élu avec 78,51 % des voix.
Notre histoire démontre que l’élection présidentielle au suffrage universel indirect n’est pas forcément un signe de faiblesse. L’opposition entre un président soumis aux partis sous les IIIe et IVe Républiques, d’une part, et l’inauguration du présidentialisme dès le début de la Ve République, d’autre part, en est la preuve. Il n’est donc guère étonnant de constater cette dialectique à l’étranger. En Allemagne, l’élection directe et les attributions jugées trop larges du président contribuent à l’arrivée au pouvoir de Hitler, sous la République de Weimar. En réaction, le Bundespräsident est, depuis 1949, élu par le Bundesversammlug, une assemblée fédérale ad hoc (article 54, al. 1 LF). Il est tributaire des partis, ce « qui leur permet de contrôler à la fois la désignation des candidats et l’élection elle-même » (Mathieu Dubois). Plus proche de la tradition française des IIIe et IVe Républiques, le président italien est élu par les deux chambres du Parlement réunies en Congrès et des délégués des régions « de manière à assurer la représentation des minorités » (article 83, al. 2 C). Toutefois, les conditions sont plus contraignantes. La majorité des deux tiers est exigée aux trois premiers tours, la majorité absolue par la suite. À l’image de l’Allemagne, « le lien chef de l’État-peuple étant réputé dangereux au regard de l’expérience fasciste, les constituants récusent toute élection au suffrage universel direct » (Franck Laffaille). L’esprit de consensus lié au mode de scrutin fait du président l’incarnation de l’unité nationale. Aux États-Unis, le président est élu par le collège des grands électeurs. Le mandat impératif confine alors à l’élection directe. Surtout, le scrutin majoritaire à un tour peut générer des distorsions. En 2016, minoritaire en voix, Donald Trump est élu car majoritaire en grands électeurs. Ce n’est pas une première (Hayes en 1876, Harrison en 1888, Bush en 2000), mais l’écart des voix (2,8 millions) est inédit. Difficile de ne pas y voir une faille dans la démocratie américaine. Il reste que cette procédure symbolise le fédéralisme, « premier élément fondateur du système américain » (Arnaud Coutant). En ce moment, le débat outre-Atlantique porte davantage sur la certification des votes que sur le mode de scrutin. Comme le souligne Olivier Dard dans sa conclusion, l’élection présidentielle (directe ou indirecte) est « tout autant le temps fort que le pivot de la politique française ». Les exemples étrangers semblent le confirmer. Au temps de la médiatisation à outrance, la lecture de cet autre scrutin présidentiel donne matière à réfléchir sur notre présent et notre avenir.