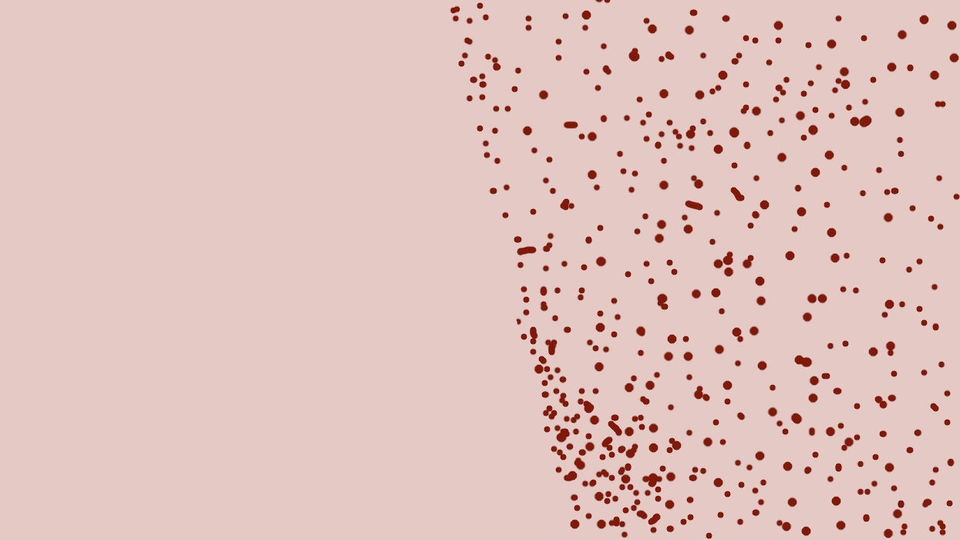"Chercher de nouveaux chemins avec mon corps" : les Françaises à l'assaut du breakdance
Elles entrent dans l’arène, il est dix-huit heures trente à l’Ergo Arena de Gdansk en Pologne. Le 6 novembre, la salle est déjà pleine à craquer quand les B-Girls sont présentées au public pour la finale de l’évènement de breakdance le plus médiatisé au monde. Le Red Bull BC One, pour la première fois de son existence, propose le même nombre de danseuses que de danseurs : elles sont donc 16 à s’élancer pour tenter de remporter le titre dont certaines ont rêvé enfants.
Avant qu’elles arrivent, les garçons performent dans des battles à un contre un, le format de cette compétition. «Ça a l’air facile, mais seulement parce qu’ils sont doués. Derrière cette aisance se cachent des heures de travail, de sang, de sueur», rappelle le présentateur de la soirée. Ami, Carito, Kastet, Luma, Madmax… Ici peu de prénoms et encore moins de noms de famille, on arrive avec un surnom et on joue le jeu d’être une autre version (augmentée?) de soi pendant quelques minutes.
Le choix de la tenue, de l’énergie, et de l’intention, construisent l’image que les juges vont se faire de vous ; favorisent l’amour sonore du public, et potentiellement, vous conduisent à la victoire. De loin, l’énergie des danseuses pourrait leur donner un air de ressemblance. Dans la réalité, 20 ans d’écart peuvent séparer deux B- Girls. Certaines, ont 18 ans et sortent de l’adolescence, pendant qu’une autre, 37 ans, allaite son enfant en coulisses juste avant de monter sur scène. Parmi les meilleures mondiales, il y a Fanny, qui a remporté la finale en France. Andrea qui a obtenu une «wild card» (une qualification directe en finale, NDLR) pour venir en Pologne, et Sarah, qui juge pour la première fois une compétition de cette importance. Rencontre avec les meilleures Françaises de la scène du breakdance.
Andrea Mondoloni, 25 ans, Montpelliéraine
San Andrea, de son nom de scène, vient de perdre dès le premier tour. Au moment de l’interview, la finale continue sans elle. Elle commente les résultats avec Fanny, la deuxième et dernière Française éliminée. Et évoque sa supportrice de mère qui, en live depuis la France, a vu perdre sa fille : «Elle était très attachée à ce que l’on fasse réellement ce que l’on aime, sans s’inquiéter de nos choix. On s’entraînait dans le salon et quand on se filmait elle venait danser. Elle croyait tellement en nous, qu’elle m’a permis d’avoir une confiance en moi qui ne me quitte pas ».
Andrea commence le break avec son frère à l’âge de 12 ans. Ils sont seuls à pratiquer dans leur village d’origine. À Rians, dans le Var, on peut apprendre à danse le jazz, le hip hop, «on faisait même la figure du Scorpion, ce qui ne voulait rien dire», mais il n'existe pas encore de cours pour ce qui se danse sur la terrasse familiale. Un cousin leur montre des mouvements. Frère et soeur se prennent de passion pour le break. Ils regardent des vidéos, dansent ensemble. Elle rit : «C’était tout et n’importe quoi, mais mon frère avait de petites bases, preuve qu’il avait déjà bien regardé YouTube».
Durant tout son collège, elle danse dans le salon en allant à quelques évènements, mais pas plus. Un Bac S plus tard, elle suit son frère à Montpellier et devient très vite professionnelle. En arrivant en Occitanie, Andrea commence par faire six mois d’école du cirque, travaille pour une compagnie, puis une autre, jusqu’à devenir officiellement intermittente et rentrer moins souvent chez elle. «La danse a été une deuxième éducation, après celle de mes parents. C’est une discipline qui nous fait grandir plus vite. Quand je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma danse et inversement ».

Comme beaucoup, Andrea ne pensait pas pouvoir vivre de la danse. Elle le dit sincèrement, comme quand elle se raconte, ponctuant ses histoires d’un grand rire franc. «Quand on a 14 ans, on a tendance à vouloir tout faire comme les autres. ‘Si elle a les cheveux raides, moi aussi je les veux’. La danse m’a permis de me trouver. Quand j’ai commencé à breaker je me foutais de ce que pouvaient penser les autres». Un moyen d’expression qui se transforme en besoin. Aujourd’hui elle alterne les jours où elle est en résidence avec des compagnies, et ceux où elle prend du temps pour elle à la maison ; sans oublier le travail avec son groupe, avec qui elle entretient «une philosophie de danse commune».
Le quotidien d'Andrea au sein des compagnie est assez millimétré : entre 6 et 8 heures de danse par jour, avec une pause déjeuner et des horaires fixes. Même si cela demande une vraie rigueur, et le fait d'y sacrifier toute sa vie, ce travail lui apporte plus qu’une vie de sportive de haut niveau. «J’aime bien me dire que je vais chercher de nouveaux chemins avec mon corps, réfléchir avec la danse». Si elle reconnaît qu’elle regardait cette compétition avec des étoiles dans les yeux, elle admet se diriger vers une autre approche, plus chaleureuse, familiale : «Je suis très fière, mais plus que de gagner, ce qui compte aujourd’hui à mes yeux c’est d’avoir passé une semaine avec les meilleures B-Girls du monde ».
Sarah Bee, 32 ans, danseuse hip -hop et juge
Madame Figaro.- Comment devient-on juge de cette compétition ? Sarah Bee.- C’est l’organisation qui nous propose d’être juge, on ne pose pas une candidature ! Mais je pense que c’est l’expérience, la maturité et le parcours qui font la différence. J’ai participé deux fois, dont la première année où les femmes dansaient en 2018. J’ai déjà gagné la finale française, mais pas internationale. Être juge, c’est un vrai engagement sur l’année, et non uniquement sur cet évènement.
Comment s’en sont sorties les femmes cette année ? C’était incroyable. J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de niveau, de la part de générations diverses, certaines ont 20 ans d’écart ! On peut voir une différence : les plus jeunes ont plus envie, elles ont moins la culture du hip-hop, elle font des choses spectaculaires. Tandis que les trentenaires sont plus dans le flow, le toucher, l’originalité, ce qui est le plus dur à obtenir dans le break. Ces dernières années, les plus jeunes femmes font beaucoup de progrès techniques, mais il faut qu’elles travaillent leur originalité. Certaines ont déjà fait six ans de gymnastique ou de capoeira avant d’arriver, elles ont une meilleure connaissance de leur corps, mais pas forcément de la danse. On ne danse aussi pas pour les mêmes raisons : les trentenaires n’ont jamais commencé pour la compétition, mais plutôt pour partager avec leurs amis, par exemple. La compétition est tout de même allégée pour les filles qui font trois passages en moins que les garçons. En terme de cardio et de nombres de mouvements, c’est énorme.
Quels sont les critères de jugement ? Nous sommes cinq juges, avec des approches différentes. Personnellement je prends tout en compte. J’aime la musicalité, j’aime les gens qui dansent sur le moment, leur écriture, comment ils se présentent… L’idée est aussi de regarder comment ils investissent la scène : est-ce qu’ils l’occupent ou est-ce qu’elle les «mange» ? Cet endroit peut faire perdre les moyens de beaucoup de danseurs. Pour nous, c’est la plus grosse compétition mondiale de breakdance. Les gens qui vont jusqu’en finale font beaucoup de recherche, ils disposent de beaucoup «d’armes», de mouvements techniques. Ils ne se contentent pas de venir réciter un passage, ils adaptent ce qu’ils savent faire à la musique qui n’est pas connue à l’avance. Pour gagner le Red Bull BC One, il faut beaucoup se préparer, avoir des petits enchaînements à soi, et une belle mémoire musculaire pour se laisser porter par la musique. Freestyler du début jusqu’à la fin, sans connaître bien ses mouvements, c’est un risque. Si, lors d'une battle, on tombe sur quelqu’un qui a beaucoup de mouvements, il ne faut pas venir qu’avec le dessert. Quand je suis juge, je ne m’attends pas à voir quelque chose, j’assiste à une conversation entre deux danseurs. D’ailleurs, je ne vote jamais contre quelqu’un, mais plutôt pour quelqu’un d’autre.
Comment accède-t-on à la culture hip hop, est-elle difficile à aborder ? Le break est accessible à tout le monde. Là où j'ai grandi, la danse classique, par exemple, même si j’adore ça, n’était pas envisageable pour moi. En dehors de la question de l’argent, si j'avais pu prendre un cours, comment m’aurait-on regardée à 13 ans, toute raide, sans avoir les codes ? Dans le break, la porte est ouverte à tout le monde : si tu as envie tu viens et tu t’entraînes avec les autres. J’ai appris à breaker en me jetant sur un carton, et en me blessant !
Fanny Bouddavong, 23 ans, Rennaise
Championne de France, Fanny est une danseuse de 23 ans, qui habite à Rennes. Elle revient sur son parcours et la compétition.
Madame Figaro.- Comment avez-vous appris à danser le break ?Fanny.- J’ai toujours voulu suivre mes frères. Après le foot, le karaté… Mon objectif c’était tout de même de les embêter ! Je suis finalement la seule qui a fait du break son métier. J’ai eu la chance d’avoir des parents qui m’ont toujours soutenue. Grâce à la danse, ma timidité a reculé. Je découvre le monde, j’apprends beaucoup des autres en me révélant au fur et à mesure.
Comment expliquez-vous votre défaite ?Je pense que c’est très subjectif, cela dépend beaucoup du jury que l’on a en face de nous. Je sais que j’aurais pu mieux faire, m’exprimer davantage, mais j’ai réussi à montrer «ma danse» sur une scène où la compétition a beaucoup d’importance. Quand on arrive jusqu'ici, on peut oublier que l’on fait cela parce qu’on aime la danse. Le plus important pour moi était de mettre en avant ce que j’ai au fond de moi et de m’amuser. Mon adversaire a une technique exceptionnelle et elle savait exactement ce qu’elle avait envie de faire. Personnellement je préfère laisser aller mon corps là où il le souhaite, sans planifier à l'avance, en me concentrant sur la musique et l'énergie. Mais c’est une prise de risques que l’on peut payer cher.
Comment sait-on que l’on veut faire de la danse son métier ?Au départ j’ai beaucoup douté, notamment lors des premiers refus, qui sont fragilisants. Aujourd’hui, je sais que je n’ai pas de plan B, donc mon plan A doit fonctionner. Depuis l’arrivée du breakdance au Jeux Olympiques, il y a ce choix qui s’offre à nous : partir dans une dynamique de compétition, ou être davantage dans des sessions «jam» qui révèlent l’importance de l’énergie, de l’échange, qui est le coeur de cette danse. J'ai tout de même peur que l'arrivée aux JO nous fasse perdre l’essence de ce que l'on fait.Comment ressentez-vous le fait d’être une femme dans ce milieu ?Personnellement, je préfère danser dans des battles mixtes, que de me cantonner aux battles féminines. Je ne ressens pas de jugement de la part des hommes, mais cela dépend comment on se positionne par rapport à cela. Si tu n’es pas sûre de toi, que tu danses uniquement dans des battles de filles, c’est plus difficile de trouver sa place. En revanche, il reste encore beaucoup de progrès à faire, comme l’égalité dans les «prizes money» (les sommes que remportent les gagnants, NDLR) par exemple.