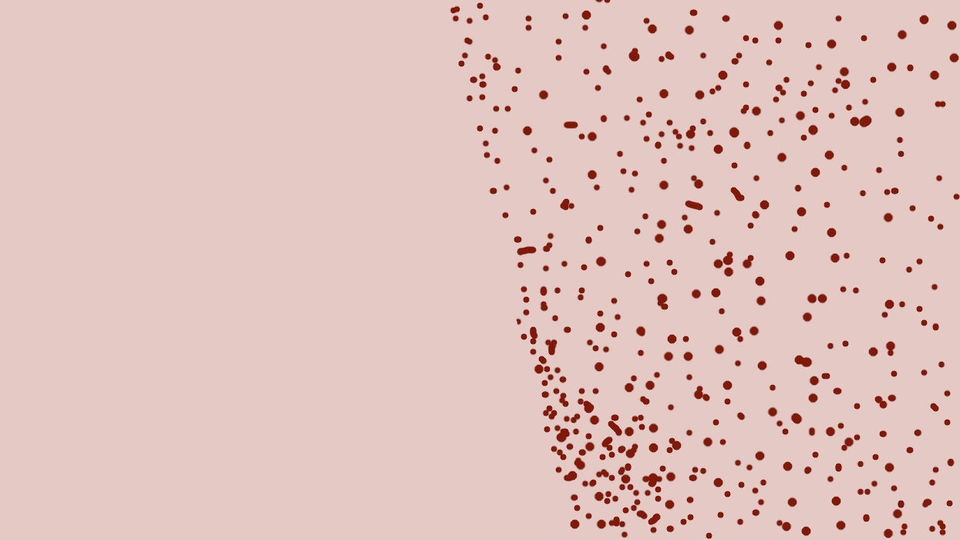Torture et internement forcé: la guerre des talibans contre les toxicomanes
À Kaboul, Afghanistan
Au cœur de Dasht-e-Barchi, à l'ouest de Kaboul, un homme déambule, les yeux écarquillés. Il s'enfonce dans les entrailles de la rivière Paghman, ou du moins ce qu'il en reste. Le cours d'eau qui traverse la capitale afghane ne forme plus qu'un filet liquide jaunâtre, et des poches de vase éparses. À quelques mètres, sous le pont Pul-e-Sokhta (le «pont brûlé» en français), des âmes errent sans but. Tels des zombies, certains zigzaguent sur le sol humide. D'autres sont assis en petits groupes. Chaque jour, des centaines d'Afghans se retrouvent ici pour prendre leur dose d'opium, de crack ou d'héroïne.
Pul-e-Sokhta, le pont des drogués
Contre un mur, un homme saisit une écharpe d'une main tremblante pour se cacher des passants. Il s'apprête à prendre un shoot de bonheur. Pendant quelques heures, le temps va s'arrêter pour lui. Il va enterrer ses soucis. Tout autour, une dizaine de tentes sont installées. De nombreux addicts dorment sur place, car ils n'ont plus de contact avec leur famille.
C'est le cas d'Amir. Il a à peine 30 ans, mais il en paraît 40. Originaire de Mazâr-e-Chârif, dans le nord du pays, il est accro à la méthamphétamine depuis deux ans: «J'en consomme huit fois par jour», dit-il. Appelée «shisheh» en Afghanistan (littéralement le «verre»), cette drogue est très prisée pour son faible coût et sa consommation facile. En 2019, les autorités ont saisi 935 kilos de méthamphétamine; 180 l'année précédente. L'addiction à la meth aurait dépassé l'opium et son dérivé, l'héroïne.
Un consommateur de crack du quartier de Dasht-e-Barchi montre son matériel. Kaboul, Afghanistan, le 24 novembre 2021. | Florient Zwein / Hans Lucas
Comme beaucoup d'addicts, Amir a commencé car il était «au chômage, désespéré par la vie». Des amis lui ont proposé de prendre sa première dose. La situation socio-économique, le traumatisme de la guerre et l'influence de l'entourage sont les facteurs principaux qui poussent certains Afghans vers la drogue. L'Afghanistan, premier producteur d'opium au monde, n'alimente pas seulement les marchés européens en héroïne: les Afghans sont eux-mêmes d'importants consommateurs.
Au total, 3,5 millions de personnes seraient addictes au moins à une drogue, sur une population de 40 millions d'Afghans: un record. «La drogue est partout. Il est facile de s'en procurer, affirme Amir. Des dealers viennent régulièrement nous en vendre sous le pont.» Pour enrailler le phénomène, le pays a toujours privilégié la répression plutôt que la prévention. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir en août dernier, la «méthode forte» s'est accentuée.
À LIRE AUSSI
Qui reste-t-il en Afghanistan maintenant que les États-Unis sont partis?
Répression sans prévention
Tout comme Amir, Obed vient sous le pont pour «consommer tranquille». Sa famille ignore qu'il est ici: «Ma femme a demandé le divorce. Le shisheh rend agressif et ma vie sexuelle est affectée.» Dans les entrailles de Paghman, tous vivent au rythme de leur dose de drogue. L'ambiance est électrique: «Parfois, on se bat et on se pique nos doses, relève Obed. Moi-même, j'ai déjà volé pour me procurer de la drogue.»
Mais le plus grand danger à Pul-e-Sokhta reste l'insalubrité. Faute de moyens pour s'acheter des seringues, les consommateurs d'héroïne s'échangent leur matériel. «Ces pratiques renforcent les infections bactériennes et les infections virales comme le VIH et l'hépatite C», affirme le docteur Michaël Bisch, responsable du département d'addictologie au Centre psychothérapique de Nancy.
Interrogés sur le sujet, les toxicomanes assurent qu'aucune structure ne les aide à consommer dans de meilleures conditions. En 2012, Médecins du monde avait développé un programme d'accompagnement des addicts en distribuant des seringues stérilisées et en offrant un traitement de substitution à l'héroïne, la méthadone. Mais l'ONG française a stoppé ses actions dans le pays l'année suivante. Depuis, la prévention semble limitée, voire inexistante. Faute d'assistance des pouvoirs publics et des ONG, les overdoses sont fréquentes: «Il y a trois cadavres sous le pont. Ils sont là depuis plusieurs jours, personne n'est venu les récupérer, indique Amir. Évidemment, ils sont morts par overdose.»
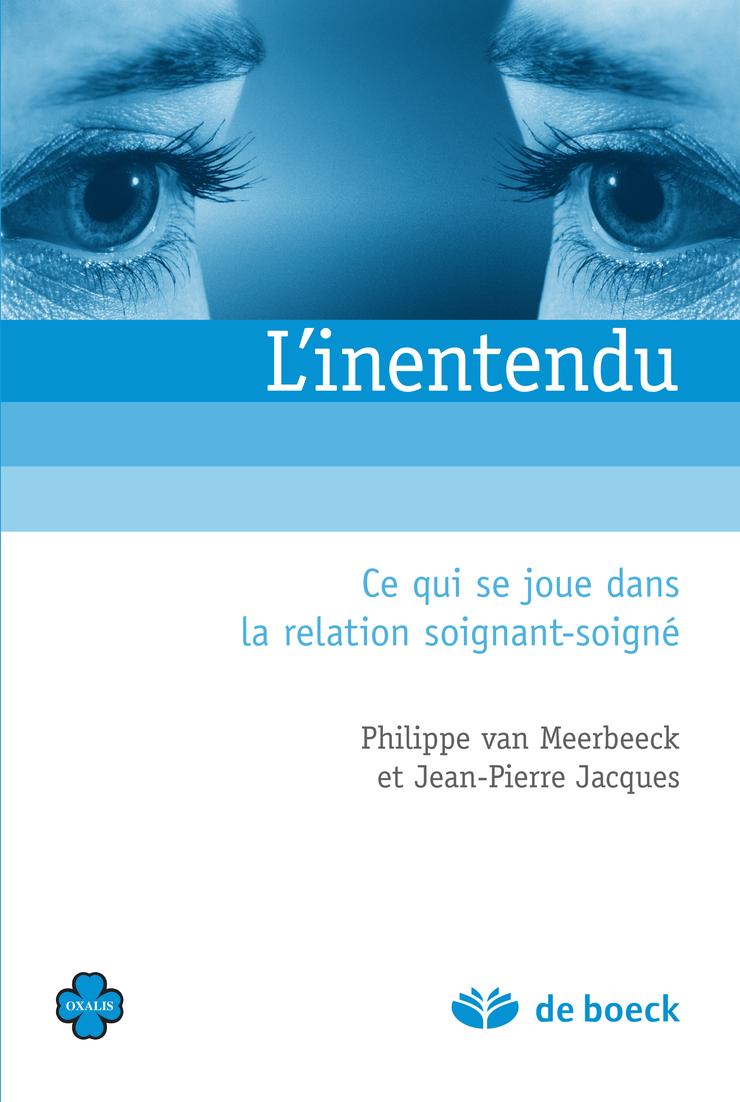
De nombreux addicts se regroupent près du pont de Pul-e-Sokhta, dans le quartier de Dasht-e-Barchi, à Kaboul, en Afghanistan, le 24 novembre 2021. | Florient Zwein / Hans Lucas
Torture et hospitalisations forcées
Les toxicomanes scrutent les environs d'un air inquiet: «Il y a régulièrement des descentes organisées par la police talibane, affirme Obed. Moi-même, j'ai été arrêté, je suis resté trois jours au poste. Là-bas, les talibans m'ont torturé. Ils m'ont couché sur le ventre, frappé, puis électrocuté!» Amir acquiesce: «Ils nous traitent comme des chiens, comme des moins que rien.»
Occasionnellement, à la tombée de la nuit, les combattants talibans devenus policiers parcourent les mondes souterrains de Pul-e-Sokhta à la recherche de proies faciles. Une fois rassemblés, les addicts sont souvent battus, et emmenés de force dans des centres de traitement.
À LIRE AUSSI
La justice comme arme de guerre pour comprendre le succès des talibans
Jasmine Bhatia, conférencière en sciences politiques à Birkbeck (Université de Londres), souligne les contradictions du mouvement taliban: «Du fait de leur idéologie religieuse, les talibans répriment fermement la consommation de drogue. Mais on ne retrouve pas les mêmes restrictions concernant les trafics. Sur ce plan, ils ont développé une approche pragmatique, ils ont adapté leur idéologie. En 2000-2001, quand ils étaient au pouvoir, les talibans avaient stoppé la production d'opium de manière fulgurante. Mais après la chute de leur régime (2001), redevenus insurgés, ils ont largement utilisé le trafic de drogue pour se financer.»
Se financer, et surtout obtenir des soutiens locaux. En facilitant la culture du pavot à opium, les talibans ont obtenu des appuis dans les campagnes: à cause du manque de débouchés économiques, de nombreux paysans afghans n'ont d'autre choix que de cultiver cette herbacée. L'Émirat islamique tolère aujourd'hui cette pratique: «C'est une tradition ancienne», se défend le mollah Abdulhaq Akhundzada, responsable taliban du département dédié au trafic de stupéfiants au ministère de l'Intérieur. La répression des consommateurs semble donc être une «vitrine» censée montrer que des efforts sont tout de même réalisés en matière de lutte contre la drogue.
En périphérie de Kaboul, sur la route menant à Jalalabad, des talibans armés surveillent l'entrée de l'hôpital Ibn Sina, qui compte mille lits destinés aux toxicomanes. À l'intérieur, des centaines de patients sont réunis dans une cour. Crânes rasés, habillés d'un uniforme rayé bleu et blanc, certains sont allongés au sol, profitant des rayons de soleil qui caressent leur peau. D'autres déambulent entre les arbres, l'air absent.
Parmi eux, Ali, les traits creusés, le corps maigre, est assis sur un banc: «Je suis addict à l'opium depuis vingt ans, indique-t-il. J'ai commencé en Iran quand je travaillais comme vendeur de tapis.» La pratique est courante, étant donnée la facilité d'accès aux drogues dans le pays voisin. «J'ai été arrêté par les talibans il y a une vingtaine de jours, raconte Ali. Ils m'ont frappé au ventre à plusieurs reprises.» Autour de lui, une trentaine de patients acquiescent vivement, affirmant avoir aussi été victimes de torture avant d'être envoyés dans le centre hospitalier.
Des consommateurs de drogues internés dans le centre de traitement des toxicomanes d'Ibn Sina, à Kaboul, en Afghanistan, le 25 novembre 2021. | Florient Zwein / Hans Lucas
Interrogé sur la question des violences policières, le mollah Abdulhaq Akhundzada affirme que «des débordements ont effectivement eu lieu au début. Mais aujourd'hui, les toxicomanes sont bien traités par la police.» Pourtant, tous les addicts rencontrés qui ont été arrêtés par les talibans nous affirment avoir subi des violences physiques et morales, même très récemment. Ali se racle la gorge avant de reprendre, d'une voix rauque: «Après m'avoir frappé, ils m'ont emmené de force dans ce centre. Je suis enfermé depuis vingt-et-un jours.»
Des centaines de toxicomanes arrêtés par la police ont ainsi été forcés d'entamer une cure de désintoxication, avec obligation de rester quarante-cinq jours dans l'hôpital Ibn Sina. Or selon les recherches en matière de sevrage aux drogues, une personne dépendante des drogues doit être consentante pour débuter une cure de désintoxication: «La contrainte médicale pour les soins addictologiques ne fonctionne pas, rappelle le docteur Michaël Bisch. Faire un sevrage non choisi est une expérience très désagréable.» Et de fait, en cas de contrainte médicale, le risque de rechute est élevé. Non seulement les toxicomanes souffrent sur le plan physique et psychologique, mais les moyens humains et financiers déployés pour l'arrestation et la prise en charge au sein de l'hôpital sont inutilement gâchés: «C'est ma deuxième fois dans ce centre. J'ai rapidement rechuté après ma première cure. C'est le cas de beaucoup de patients ici», assure Ahmad, un patient.
Ali, addict à la drogue depuis vingt ans, a été tabassé par la police avant d'être envoyé à l'hôpital d'Ibn Sina. Kaboul, Afghanistan, le 25 novembre 2021. | Florient Zwein / Hans Lucas
À LIRE AUSSI
La victoire des talibans en Afghanistan ne devrait surprendre personne
Hôpital plein et caisses vides
Les dortoirs d'Ibn Sina sont concentrés dans de petits bâtiments à l'arrière du centre. Les chambres classiques réunissent plus d'une centaine de lits, mais dans certaines pièces, les patients dorment à même le sol: «La capacité de cet hôpital s'élève à mille lits. Mais depuis l'arrivée des talibans, le nombre d'arrestations a explosé», affirme Ahmad Zoher Sultani, le directeur de l'hôpital. «Nous devons maintenant accueillir trois mille patients. Nous n'avons pas notre mot à dire quand les talibans débarquent avec de nouveaux toxicomanes…»
Dans une pièce d'une centaine de mètres carrés, des dizaines de patients sont allongés les uns à côté des autres sur une fine moquette dégradée. «On ne dort pas correctement. On doit parfois se partager une couverture à trois, le sol est froid et on n'a pas de chauffage. Les nuits à Kaboul sont glaciales!», se désole Walid, entouré d'un groupe de camarades. Interné depuis vingt-et-un jours, Walid était addict à l'opium. Les conditions de vie dans le centre sont d'autant plus ardues pour un patient en sevrage: «Je ressens les choses avec plus d'intensité. Mon corps est douloureux à cause du manque de drogue», explique-t-il.
Selon le psychiatre Michaël Bisch, enfermer des addicts dans des conditions si mauvaises est contre-productif: «Si un toxicomane fait un passage dans ce centre, le jour où il a vraiment envie d'arrêter la drogue, il aura en tête un terrible souvenir de son précédent sevrage. Le fait d'avoir une expérience très négative ferme la porte aux structures de soins dans le futur.»
Un consommateur de crack souffre d'un manque de drogue dans le centre de traitement des toxicomanes d'Ibn Sina. Kaboul, Afghanistan, le 25 novembre 2021. | Florient Zwein / Hans Lucas
Adossés à un mur, dans la cour intérieure, plusieurs patients portent leurs mains à la bouche en signe de faim: «Nous n'avons pas assez à manger», affirme Samir. Le médecin qui nous accompagne commente, l'air gêné: «Nous manquons de moyens dans le centre…» Depuis la prise de pouvoir des talibans en août dernier et l'instauration de sanctions internationales, les caisses de l'État afghan sont vides. Cela fait plusieurs mois déjà que le personnel soignant ne perçoit plus de salaire.
«Après la chute de Kaboul, environ cent-cinquante employés du centre ont fui vers l'étranger, note le directeur du centre. Moi-même, je suis dans l'attente d'un visa. Au total, nous avions quatre cents employés. Nous sommes deux-cent-cinquante aujourd'hui. Presque la moitié est partie et le nombre de patients a triplé.» Faute de salaire à proposer, le centre n'a pas pu recruter de nouveaux employés. Les carences en matière de personnel se retrouvent dans l'hygiène des lieux. Dans les bâtiments où dorment les patients, les sols sont recouverts de crasse et une odeur de pourriture a envahi l'espace. Les lits sont rouillés, à moitié défoncés, et semblent prêts à se briser. «La situation est intenable», souffle Atiqullah, un aide-soignant du centre.
Aujourd'hui, pour la nourriture et les médicaments, l'hôpital fonctionne encore sur le budget de 2021. Le directeur, tournant son regard vers la cantine de l'hôpital, ne cache pas son inquiétude: «L'Afghanistan est de plus en plus isolé et l'aide internationale est limitée.» Alors que la crise financière empire, le centre hospitalier pourrait bientôt manquer de moyens pour nourrir les patients: «En 2022, nous risquons de fermer nos portes.»