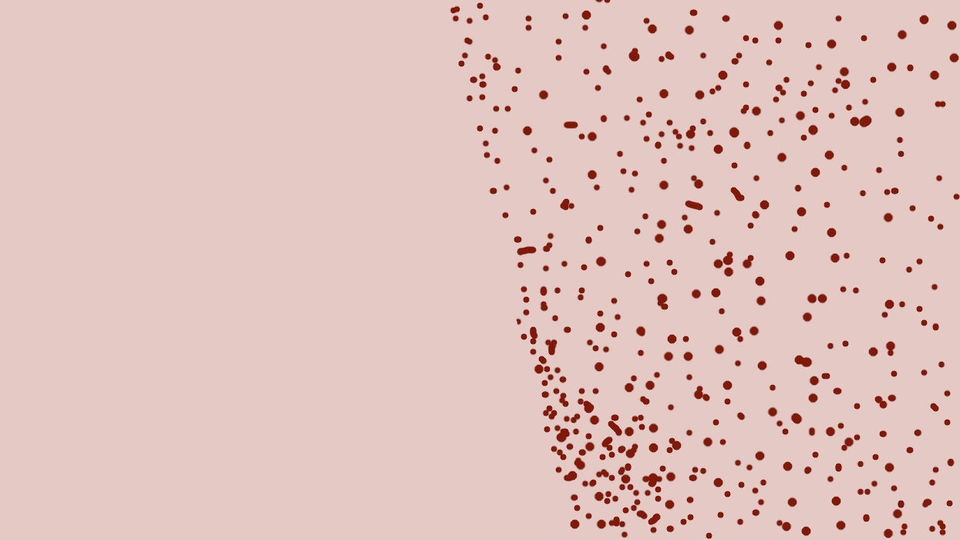[Entretien] On a parlé bienveillance, méchanceté et création artistique avec Perez
Deux ans après “SUREX”, voici Perez de retour avec un court EP de quatre titres où des rires de hyènes éclatent dans une étrange odeur de vanille. Belle réflexion sur l’étrangeté. Rencontre.
Est-on toujours soi-même ? Où se niche le cœur de son identité propre ? Où va-t-on ? Perd-on des morceaux de soi en route ? Faut-il s’en inquiéter ? Que fait-on des couches d’émotions et d’idées que déposent sur nous les œuvres côtoyées, les expériences subies ou choisies ? Comment gérer sa méchanceté ? Et celle des autres ? Comment penser et dire ce que l’on ne sait pas encore que l’on peut penser et dire ? Comment sortir de soi-même ? Que faire de sa tristesse ? Nage-t-on dans l’absurde ?
Autant de questionnements qui habitent, en filigrane, l’œuvre de Julien Perez, depuis ses débuts avec Cramer, premier EP sorti sous son simple nom de famille. Si ses débuts rappelaient le Bashung de Play Blessures comme l’amoureuse mélancolie du dancefloor d’Étienne Daho (qui le photographia pour l’exposition Daho l’aime Pop ! présentée en 2017 à La Philharmonie de Paris), Perez s’est éloigné de la tradition pop française pour expérimenter davantage et bâtir ainsi un monde légèrement décalé, semi-onirique. Un monde qui serait presque le nôtre mais pas tout à fait, comme un reflet de soi-même dans le miroir en pleine montée de LSD (excellent récit de cette expérience à retrouver dans Ce qu’aimer veut dire de Mathieu Lindon). Un soi qui ne le serait plus totalement. Et n’est-ce pas là, en définitive, le but de la vie (encore faudrait-il considérer qu’il y en ait un…) que de parvenir à sortir de soi, ici et là, afin de muter ?
La transformation, voilà ce qui anime Perez. Pas radicale, plutôt aérienne, douteuse, questionneuse, sceptique, cherchant à gratter un peu la surface tout en conservant le format de la chanson pop classique que chacun·e peut attraper et gober. Avec son nouvel ep SADOS, Perez offre une belle suite à SUREX, son dernier album paru pré-confinement, il y a deux ans., intrigant mélange d’écriture poétique, d’electro-pop, de triturations du son et de superposition de couches, sans rien de pompeux, avec le désir de ne pas choisir une voie mais plutôt de voir ce que l’agencement de plusieurs voies pourraient donner.
SADOS précède une exposition sur le thème de la méchanceté que Julien Perez, sous sa casquette – nouvelle – de plasticien présentera au centre d’art L’Onde à Vélizy au printemps. Rencontre avec quelqu’un qui cherche.
Ton dossier de presse s’accompagne d’une interview sur ton nouvel EP SADOS. Le journalisme culturel ne sert-il plus à rien ?
C’est une manière de fournir des pistes, de donner des infos qui me paraissent importantes. Le format interview me paraissait plus léger que des textes descriptifs comme je le faisais avant. J’ai vu que tu avais participé à une émission sur le journalisme culturel sur France Culture. Effectivement, il n’y a qu’une place réduite donnée à la critique culturelle dans les médias et je trouve ça déplorable. Il y a plus de place donnée à une vidéo qui fait le buzz qu’à la critique d’un livre ou d’un disque.
Tu lis des critiques culturelles ?
J’en ai pas mal lu. Un peu moins aujourd’hui. Mais je continue de tomber sur des critiques qui me donnent envie. J’écoute beaucoup la radio. Même si la critique n’est plus le seul moyen de savoir ce qui se fait, elle reste importante sur des questions de fond. Je pense aussi à Audimat, dont j’aime bien la sociologie de la culture. C’est essentiel.
Dans cette fameuse auto-interview, tu dis : “Les quatre chansons de cet EP sont une sorte de substrat, ce sont celles qui résument le mieux les interrogations et les sensations que j’ai eues pendant cette période.” Quelles sont ces interrogations et ces sensations ?
Au départ, je me suis dit qu’au delà de sa dimension dramatique, ce que nous vivions pouvait amener sur la scène des questionnements écologiques, de santé, de justice. Puis finalement, plus le temps est passé, plus on a arrêté d’applaudir les soignants et plus on a recommencé à se tirer dans les pattes. Le sujet de la présidentielle, c’est l’identité nationale… Rien n’a bougé. C’est un sentiment contrasté.e On se sent appartenir à l’humanité, on sent que tout est imbriqué à l’époque de la mondialisation, qu’on fait parti d’un tout, d’un collectif ; et en même temps, la dimension dramatique, catastrophique même, de la situation n’a pas suffi à faire bouger les lignes…
Dirais-tu qu’il y a une dimension politique dans ta musique ?
Pas frontalement. Je ne fais pas de prosélytisme. En revanche, je pense qu’elle est influencée par le contexte. C’est difficile aujourd’hui d’être dans le solipsisme, de parler de ses problèmes perso, de ses histoires de cul. Ça transparaît sur Hommage par exemple, avec cette histoire d’apocalypse dans un supermarché. Le climat politique délétère de l’époque infuse mes paroles et mon imaginaire.
La situation dramatique pourrait justement pousser au repli sur soi, au solipsisme, non ?
Le fantasme d’aller vivre à la campagne et de fermer les écoutilles… ce sont des pensées qui ont traversé l’esprit de beaucoup de personnes je suppose, mais on se rend compte que notre vie est faite de relations sociales. On peut difficilement tout couper et se barrer. On est embarqués dans le même truc et la pratique artistique me paraît salvatrice pour celles et ceux qui la font, et celles et ceux qui la réceptionnent. Les œuvres d’art qui touchent élargissent le champ des possibles et donnent souvent envie de créer. Ce sont des balises qui permettent de passer à une action sortant du périmètre de l’art.
Tu n’es jamais paralysé par le doute ? Tu ne te dis jamais que rien ne sert à rien ?
![[Entretien] On a parlé bienveillance, méchanceté et création artistique avec Perez [Entretien] On a parlé bienveillance, méchanceté et création artistique avec Perez](https://website-google-hk.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/drawing/article_results_6/2022/2/27/312ce499cb4738be71a5da2441d6985e.jpeg)
La pratique artistique a toujours été présente, dans les cavernes, dans les prisons, sous les dictatures. C’est aussi une forme d’échappatoire d’aller puiser des ressources dans l’imaginaire, dans l’intellect, quand les conditions matérielles et de vie ne sont pas bonnes. Donc non, ce n’est pas vain, même si le contexte peut être décourageant sur des points logistiques, pragmatiques… Faire de la musique sans salles de concert, ne pas sortir de disque car il y a une pénurie de matière… Mais je ne remets pas en question le fait de faire de l’art.
Il y a un certain retour au field recording actuellement, des bruits de nature principalement, de rivière, de pluie. Tu n’as pas eu envie d’en intégrer sur ton EP ?
Il y a du field recording sur mon EP ! Via des cris de gens dans un rollercoaster sur Hommage, où l’on entend aussi une musique de supermarché. Il y a des bruits de gens qui parlent au début de Vanille. J’ai toujours aimé en mettre dans mes morceaux. Ces sons qui ne viennent pas du studio donnent un effet de réel. J’aime composer différentes dimensions dans un même morceau. Sur Vanille, la voix est traitée au départ comme sur un morceau de R&B puis on m’entend chanter un peu faux et me mettre à rire. C’était une prise ratée que j’ai gardée, car ça nous fait sortir du lisse pour montrer quelque chose de plus brut, le moment de la prise, le studio, le hors champ. J’aime cette rupture, ce fait de casser la magie de la production.
D’où viennent ces sons ?
Je les enregistre sur mon téléphone, ou je les chope sur Freesound, un site participatif où plein de gens mettent des sons enregistrés sur Nagra ou sur iPhone, qui sont classés par catégorie : porte qui grince, enfant dans un parc, oiseaux… Je m’y balade aussi pour chercher des idées d’arrangement. Je pars sur des cordes, je vais chercher des grincements et tout à coup j’en trouve un qui va s’harmoniser ou créer une dissonance et je le fonds dans la musique de façon à ce qu’on ne capte même pas qu’il s’agit de field recording. C’est une manière de rendre les textures vivantes, étranges.
Tout l’EP a été produit chez toi ?
Oui, dans mon home studio, tout seul. Théo, Strip Steve, n’a pas participé à la production comme sur les précédents, même si c’est la première personne à qui j’ai fait écouter les morceaux. Je ressentais le besoin d’être dans ce truc de confinement, chez moi, seul. Ce sont quatre morceaux extraits dune grosse matière, de mois d’expérimentations. Ils me semblaient bien aller ensemble. Ils formaient un arc dramatique que je trouvais cool.
Être seul, ce n’est pas le danger de s’éparpiller ?
C’est nécessaire quand on est seul. Ce qui est chouette, dans un groupe, c’est que chacun amène ses idées, ce qui produit des conflits permanents. Or seul, c’est difficile de jouer contre soi-même ; il faut donc mettre en place des méthodes pour parvenir au même résultat qu’en groupe. Si une mélodie me plaît, je me force à en faire plusieurs versions, avec différents arrangements. Je fais de même avec les textes : je les découpe, j’en fais des cut up. Souvent je n’aime pas les premiers textes, que je trouve trop proches de moi, de mes lubies. Je vais les rendre peu à peu étrangers à moi-même en les découpant pour parvenir à quelque chose de plus onirique, faire sortir des choses que je n’arriverais pas à verbaliser de manière immédiate. Ça demande de s’éparpiller…
Dans la présentation de ton EP, tu expliques justement que l’étrangeté à soi-même peut-être “un salut”.
C’est une manière de faire de la musique. Je n’aime pas les identités arc-boutées sur elles mêmes, les gens sûrs de leurs opinions, de leurs principes. C’est important d’être constamment en évolution, en transformation, de douter. Ça implique de se sentir étranger à soi-même, mais dans un sens vertueux.
Ce n’est pas effrayant ?
Pas dans une démarche artistique. Après, se sentir perdre pied… On a tous des coups de mou, des doutes sur le sens de la vie (rires). Le souvenir de la peur peut certainement servir à créer, mais la peur elle-même paralyse. J’ai juste les mains moites et je ne fais rien. Il faut de la sérénité pour créer. Même si les matériaux peuvent être des souvenirs douloureux ou désagréables. J’ai besoin d’avoir les idées claires.
Comment les as-tu ? Tu mets en place un dispositif précis ? Une organisation ?
J’essaie d’avoir des horaires assez stricts, de faire des journées de boulot classiques, du 9 h – 18 h. Aujourd’hui ça me fait moins flipper de passer des journées à avoir l’impression de ne faire que de la merde car j’enregistre, je garde, je ressors deux ans plus tard et je pose un autre regard sur ce que je produis. J’ai besoin de produire constamment pour avoir de la matière. Je n’ai jamais attendu que ça me tombe dessus, touché par la grâce. J’ai toujours été laborieux.
Et du côté du texte ? Tu pars d’un mot ? D’une idée générale ?
Ça part souvent d’un mot. De sa sonorité. Un mot peut être musical, renvoyer un sens polysémique, ouvert pour pouvoir construire autour… Puis je bâtis une narration ou j’ajoute d’autres mots qui vont jouer avec ce premier mot par écho, par musicalité.
Pourquoi les rires des hyènes, par exemple ?
J’aime l’idée des hyènes qui rient et vont en meute. C’est une bonne image de cette culture actuelle du lynchage. Et quand j’étais petit, j’avais des livres illustrés. Je me souviens d’un troupeau de hyènes qui suivait une girafe blessée et qui attendait qu’elle s’épuise pour attaquer. Je trouvais ça fort.
Cet EP, SADOS, accompagne une exposition sur le thème de la méchanceté au centre d’art L’Onde à Vélizy au printemps.
C’est le premier jalon d’un tout qui formera une expo en avril 2022 avec Élisa Pône. L’exposition consistera en 20 entretiens filmés dans lesquels j’ai demandé à des gens de tous âges de me raconter des histoires de méchanceté subie. À la fin, je leur demandais d’écouter un morceau de musique en restant silencieux. Cela sera monté sur la lecture d’un récit de méchanceté, ce qui produira un décalage dans les attitudes, une étrangeté. Je sortirai à ce moment-là de nouveaux morceaux plus explicitement sur la méchanceté. Ce premier EP amène à ce thème, mais de façon plus lointaine. Vanille parle de cruauté, Hyène de leurs rires… Les futurs morceaux donneront un droit de réponse au méchant.
Il a un droit de réponse, le méchant ?
Oui, c’est important, on est en démocratie !
C’est quoi la méchanceté aujourd’hui ?
Contrairement à la notion philosophique de “mal” que l’on retrouve chez Hannah Arendt, la méchanceté a un côté plus enfantin, qui renvoie aussi à une expérience subjective. Très peu de penseurs se sont intéressés à la méchanceté. Et puis elle renvoie aux personnages des films de super-héros, exubérants, une figure que j’aime parce qu’elle transgresse, qu’elle est bigger than life. Brigitte Fontaine est un peu une méchante de film, comme Nick Cave, SCH, MF Doom. C’est toujours drôle, les personnages de méchants. À partir de ce moment où tu as le contrat de la fiction, tu peux dire pleins de trucs, passer des idées transgressives sous le côté carnavalesque de la fiction.
La notion de bienveillance t’agace actuellement ?
On est dans une société où les entreprises vont se réclamer de la bienveillance, et en même temps, j’ai le sentiment qu’il n’y a jamais eu autant de méchanceté dans les échanges, de la politique à l’école. Il n’ y a pas vraiment d’espace pour la confrontation, le dialogue d’idées. Ca a été réduit à des punchlines, des attaques sensationnelles… Il y a peu de temps pour développer des questions conflictuelles mais essentielles pour vivre en commun. Donc on a d’un côté des hurluberlus new-age qui parlent de bienveillance à tout bout de champ et de l’autre, des gens hyper agressifs qui estiment qu’ils ont une méchanceté légitime alors que c’est de la haine et de la violence lâches envers des gens vulnérables ou des groupes minoritaires. Il faudrait une méchanceté vertueuse.
Tu as dû réfléchir à ta propre méchanceté ?
Je regrette parfois d’avoir été méchant envers certaines personnes. J’essaie d’en tirer des conclusions et d’être quelqu’un de meilleur.
C’est important de s’améliorer ?
Oui je pense [rires]. C’est bien de ne pas se laisser aller à la sournoiserie. La bonne méchanceté, le fait d’être capable d’aborder des sujets tabous, d’aborder les choses de manière crue, de montrer une saine révolte, c’est très important.
Le clip d’Hommage reprend des photos de toi enfant. Quels sons, quels bruits sont associés à ton enfance ?
Gamin, j’habitais dans un immeuble qui donnait sur la place des Quinconces à Bordeaux, qui accueille souvent des fêtes foraines et des cirques. J’entendais des sons comme une rumeur qui pénétrait l’appartement, une petite musique de fête, des animaux… Un monde un peu féérique et flippant qui me parvenait jusqu’aux oreilles. Dans ma musique, il y a un rapport aux contes, aux récits primitifs qui nous constituent depuis qu’on est petits.
Quel récit primitif te reste-t-il de ton enfance ?
Je dirais l’apprentissage de la cruauté, de l’injustice dans les contes. La Chèvre de monsieur Seguin m’a bien marqué.
Quels sont tes premiers souvenirs d’enfance ?
Jouer tout seul. Je suis fils unique. Trouver des moyens pour rendre les jeux excitants alors que je n’avais pas vraiment de compagnons de jeu. Assez jeune, j’avais trouvé un truc : j’enregistrais ma voix sur un enregistreur cassette puis je mettais lecture, et je faisais des dialogues avec l’enregistreur. J’avais montré ça à mes parents, ça les avait fait un peu flipper, je crois. Ça me semblait être un moyen de donner de la densité, de l’épaisseur à la vie.
Retiendrais-tu une année ?
Je vois plus ça comme un flux.
As-tu un sentiment d’étrangeté quand tu penses à ton enfance ?
C’est certain. Je suis tombé il y a peu sur des textes écrits quand j’avais la vingtaine, des tentatives de nouvelles. En les relisant je ne me reconnaissais pas. Aucun souvenir de les avoir écrits, d’avoir été dans ces états d’âme, d’avoir eu ce style d’écriture… Un complet étranger.
C’est important la mémoire pour toi ?
Pas trop. C’est sain de faire des purges de souvenirs. C’est compliqué de vouloir tout garder… Notre cerveau n’est pas fait pour traiter toutes ces infos, donc il faut laisser la sélection s’opérer de manière naturelle.
C’est la même chose en musique ?
Je ne suis pas un collectionneur. Si un morceau remonte à loin, c’est assez facile avec Internet de le retrouver par association d’idées. Il y a quelques disques hyper importants que j’ai en vinyle à portée de main. Mais je ne suis pas obsédé par le fait de tout avoir bien rangé sous la main.
Un jour, tu m’as dit : “Je n’écoute pas de musique pop mais j’en fais.” C’est toujours le cas ?
Il y a des trucs très mainstream que j’aime beaucoup, comme Rosalía ou certains morceaux de The Weeknd. Mais ce n’est pas ce que je vais voir en concert par exemple. Maintenant, j’essaie daller vers des choses plus surprenantes, de la musique contemporaine, ambient, du flamenco. C’est souvent plus inspirant que d’aller voir un groupe de rock indé ou de pop électronique dont j’ai l’impression de bien connaître le jargon.
Paradoxalement, tu conserves un format chanson.
C’est ce que j’aime bien. C’est le fil rouge de ce projet. Il a beaucoup bougé depuis le début mais j’ai conservé cette volonté. Contrairement aux musiques de niche qui sont très codées, la pop permet d’agréger autour d’un projet plein d’influences différentes, un peu comme des jouets. Il y a un côté ludique dans la pop qui me plaît. Garder une évidence, des gimmicks, donne une colonne vertébrale à laquelle j’attache mes expérimentations.
À quel moment as-tu pénétré, aussi, dans le monde des arts visuels ?
Assez tôt. La première collab’ remonte à 2005 avec Saâdane Afif, qui m’avait demandé de mettre de la musique sur des paroles pour une expo au Palais de Tokyo. J’avais beaucoup d’ami·es aux Beaux-Arts. J’ai créé le groupe Exotourisme avec Dominique Gonzalez-Foerster. Ça me plaît de pouvoir penser la musique autrement que dans ce cycle consistant à sortir des disques, faire de la promo, donner des concerts. Il y a aussi des idées qui sont plus musicales, d’autres plus visuelles ou littéraires. C’est épanouissant de s’autoriser à changer de discipline artistique.
As-tu une ambition précise avec Perez ?
J’ai envie de constamment renouveler mon propos, de me montrer audacieux, inventif sur chaque disque. Faire évoluer ma pratique d’écriture. Ne pas me reposer sur une formule qui identifierait le projet. J’aime qu’il mute et aille toucher des champs de création hors de la musique pop. Et que petit à petit on puisse, lorsqu’on porte un regard rétrospectif sur ce que j’ai fait, voir les connexions, le voyage. Je ne sais pas où j’irai… mais j’aimerais que cela dessine une constellation dont je sois fier.
As-tu une obsession actuellement ?
Non, je ne suis pas obsessionnel. En musique, j’écoute beaucoup Mica Levi. J’aime bien son côté transdisciplinaire. Elle fait des performances, des musiques de film, des choses plus rock. Elle a une grande liberté. Elle pourrait quasiment être un modèle pour moi.
Une image artistique qui t’a frappée ?
Récemment, c’est l’exposition sur Derek Jarman au Crédac d’Ivry-sur-Seine. Il y a ce film qui s’appelle Blue. C’est un écran sur lequel est projetée une image bleue mais filmée, donc on voit les trucs de la pellicule. Et une voix qui est celle de son journal intime raconte la violence de son quotidien de malade du sida, de cinéaste et de peintre devenant aveugle et mourant du sida, tout en menant une divagation sur le mot bleu en anglais, qui signifie la couleur, mais aussi la tristesse. Le tout monté avec plein de musiques, de Brian Eno, de Satie, de field recording. Et tout ça se passe sur cet écran bleu qui joue sur la persistance rétinienne. Quand tu détournes ton regard puis que tu reviens dessus, tu as une sensation de variation, or l’image ne bouge pas ; tu produis tes propres hallucinations visuelles. C’est une œuvre hybride entre une installation, une expérience de cinéma, une création radiophonique… Cela m’a beaucoup touché.
Faut-il de la confiance en soi pour créer une œuvre ?
Je trouve, oui. Je ne peux pas être productif quand je doute. Confiance en soi ne veut pas dire penser qu’on est au-dessus de tout. Mais ça renvoie à l’idée de sérénité. Sentir qu’on est dans les bonnes dispositions pour faire quelque chose, et que ce n’est pas vain.
Propos recueillis par Carole Boinet
Perez, SADOS (Étoile distante), sortie le 14 janvier. En concert au Point Éphémère (Paris) le 15 février 2022.