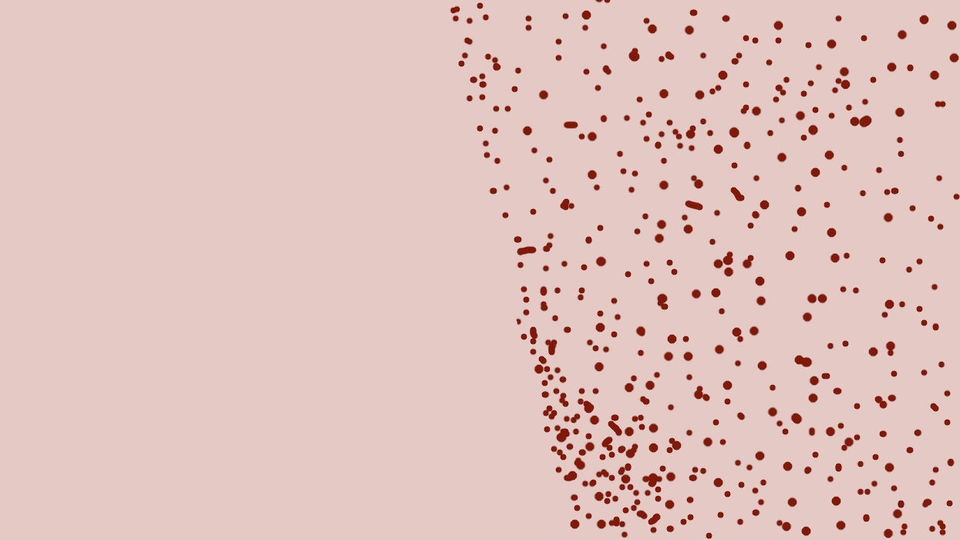Benjamin Biolay - Isabelle Adjani - Dorothée Gilbert : leur plaidoyer pour sauver la culture
On sous-estime parfois l'importance de la géométrie (et de la géographie !) dans nos vies. Reliquats d'école… Ainsi, en cette avant-veille de confinement, la danseuse étoile Dorothée Gilbert se tient impeccablement perpendiculaire à la table de notre interview, droite comme un « i ». Benjamin Biolay, lui, sirote un Coca, quasi couché sur la table, parallèle au rectangle de Formica. Non seulement ces positions marqueront tout l'entretien de leur empreinte, de leur dynamique, mais elles ne feront que s'accentuer au fil des minutes. Elle, tendue mais lumineuse et disciplinée. Lui, plus sombre, drôle et dissonant. Et puis, il y a, dans un coin de la pièce, Isabelle Adjani, venue discrètement en auditrice libre pour piocher matière à l'édito qu'elle signe dans ce numéro. Attentive, elle interviendra à la fin sur ce sujet qui les réunit tous les trois. Comment sauver la culture ? À quoi servent les artistes ? L'art est-il un commerce essentiel ?
ELLE. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ?
Dorothée Gilbert. Stressée. Le premier confinement a été compliqué. Pour un danseur, s'entraîner chez soi est une gageure : il manque l'enthousiasme, le regard, l'envie qui le pousse à travailler, à aller plus loin, il n'y a pas le but de la scène, ni l'espace ni le sol…
Benjamin Biolay. Disons que je ne suis pas complètement anéanti mais pas très optimiste pour l'avenir : c'est l'inconnu total. Pendant le premier confinement, en deux heures, je me suis rendu compte que mon seul but, c'était de jouer avec les autres. Chanter sur les réseaux sociaux était un mariage de raison : je le faisais autant pour eux que pour moi.
ELLE. Un artiste sans public, ça a du sens ?
Benjamin Biolay. La danse, la musique sont des métiers collectifs. Mettons que là, on est dans une phase d'entretien, comme un véhicule au garage, si vous voulez une comparaison.
Dorothée Gilbert. Ce qui me manque le plus, c'est le partage avec le public. On danse pour ça : ce don, cette communion, cet échange, faire oublier les tracas du quotidien. Sans public, on n'a plus de raison d'être, on n'existe pas. Peu importe le nombre de gens dans la salle. C'est un duo.
ELLE. Vous pourriez être sur scène pour deux personnes ?
Dorothée Gilbert. Mais bien sûr !
Benjamin Biolay. Quand même pas… [Rires.]
Dorothée Gilbert. Je l'ai fait pendant le premier confinement. C'est mieux que rien.
Benjamin Biolay. Le public, c'est ce qui empêche nos métiers d'être routiniers et pénibles. Chaque soir, en tournée, je joue les mêmes vingt-six titres dans le même ordre, et pourtant, chaque fois, c'est unique et différent. Je ne sais plus si c'est Charles Aznavour qui a dit : « C'est comme l'amour. Si c'est bien pour toi, c'est bien pour l'autre. » Y a ce truc qui rend tout légitime.
ELLE. Pour un danseur, l'impact est physique, aussi ?
Dorothée Gilbert. C'est à peu près comme si on demandait à un coureur de 100 mètres de s'entraîner chez lui. Quand on a repris les spectacles, on s'est rendu compte à quel point on n'était pas en forme : pour être en forme à la fois en cours et pendant les répétitions, il faut se produire.
Benjamin Biolay. C'est un cercle vertueux. J'ai donné deux concerts la semaine dernière, une expérience merveilleuse et presque traumatisante tellement on sentait que ça ne se reproduirait pas de sitôt. J'ai failli pleurer. Et pourtant, je ne suis pas du tout lacrymal : on m'a mis dans le jury d'une émission de télé-réalité, la « Nouvelle Star », ils voulaient que je chiale, y a pas eu moyen. Mais là, de voir les gens se lever dans la salle avec leurs masques, j'ai été pris de frissons. Après, ce qui nous arrive, c'est le drame ordinaire du chômage, de l'inutilité, de ne plus avoir de fonction dans la société, c'est quelque chose qui atteint le psychisme, ça pourrait paraître léger, j'entends déjà dire : « Y a quand même pire que vous », mais non, parce qu'on est comme tous les gens qui ne servent plus à rien.
ELLE. En quoi cela a-t-il changé votre rapport à vos métiers ?

Benjamin Biolay. Après mon ultime concert, je suis sorti de scène en me disant : regarde bien tout une dernière fois. Je suis un peu jeune pour avoir ce genre de pensées ! Sinon, je ne suis pas quelqu'un qui écrit des chansons spécialement joyeuses, donc je ne vois pas ce que ça peut changer à mon style ! [Rires.] Mais c'est du pathos, tout ça…
Dorothée Gilbert. Quand je suis remontée sur scène, ça a été magique, je me suis rendu compte du caractère précieux et précaire de tout ça. Et encore, on a la chance, à l'Opéra, d'être protégés par l'État, d'être payés même quand on ne travaille pas. Cela nous a permis, jusqu'ici, de vivre cette période comme une parenthèse.
Benjamin Biolay. Toi, t'es l'élite mondiale de la danse, mais, pour une étoile, il y a trois millions de danseuses au chômage. Et puis, à long terme, y a bien un mec de LREM, un banquier, qui va vous dire : « Ça fait chier l'Opéra de Paris, ça coûte trop cher. » Le plus déprimant, c'est qu'on pensait avoir un socle, une espèce de légitimité sociale, mais rien, le mépris des pouvoirs publics pour nos activités est impressionnant.
ELLE. Vous avez été déçu par les pouvoirs publics ?
Benjamin Biolay. Évidemment, il n'y a pas de concertation, pas de dialogue. Personne ne nous explique les choses, ne prend la peine de nous adresser la parole. Quand je lance une tournée de soixante-seize dates, je trouve ça un peu raide d'apprendre qu'elle ne se fera pas par la voix du président de la République en direct, à la télé, après douze minutes de suspense. C'est pas mon truc.
ELLE. Roselyne Bachelot fait-elle le job au ministère de la Culture ?
Benjamin Biolay. J'ai trouvé courageuse sa prise de parole au moment du couvre-feu, mais faut voir le camouflet qu'elle s'est pris en retour. J'aurais bien aimé un cours magistral sur le fait que la culture, ça coûte de l'argent mais ça en rapporte énormément. Eux ne voient que l'Opéra de Paris, ils ne voient pas les milliers de profs de danse en province qui donnent des cours à des gamins, ils ne voient pas le fait que, quand je vais à un spectacle, après je dîne à côté, je prends un taxi pour rentrer, etc. C'est un ensemble de choses, un système de vases communicants, qui fait que la culture rapporte beaucoup de blé. Au mois de mars, on n'a rien dit, ils se sont pris une pandémie dans la tête, mais là, ils auraient pu nous parler. Le manque de coordination, de concertation, de discussion est assez effrayant. Je suis entouré de gens dans une précarité folle, tous les musiciens, les techniciens… je ne peux pas ne pas être un petit peu en colère.
ELLE. Diriez-vous que l'art est un commerce essentiel ? De première nécessité ?
Dorothée Gilbert. Évidemment, car il soigne l'âme des gens ! Et ils en ont besoin en ce moment.
Benjamin Biolay. Des spectateurs m'ont dit des choses très émouvantes, comme : « Si on est déprimé, c'est pas bon pour le système immunitaire. » Ce n'est pas tant la question des concerts que de trouver un peu de plaisir dans la vie, d'évasion, d'élévation. La culture est une spécificité française, qui va de C. Jérôme à Chanel.
Dorothée Gilbert. On a besoin spirituellement de pouvoir s'élever à travers l'art et à travers autre chose que la religion. Je regrette que certains domaines culturels comme le ballet restent encore très élitistes, très chers et trop peu accessibles aux jeunes.
Benjamin Biolay. Ce n'est pas à nous de dire que l'art est essentiel, qu'il faut sauver la culture, on dirait qu'on prêche pour notre chapelle, c'est aux gens qui nous gouvernent.
ELLE. Il est vrai que les artistes qui se mobilisent suscitent parfois des réactions mitigées…
Benjamin Biolay. Y a un côté « ta gueule », ouais ! Quelqu'un de très haut placé m'a dit : « Vous vous en foutez, vous, votre album il marche. » Ils n'ont pas compris que c'était un truc ultra-collégial.
ELLE. Qu'attendez-vous de l'État ?
Benjamin Biolay. Qu'il pense à sa jeunesse, qu'on arrête de pénaliser les jeunes, de les montrer du doigt, qu'on leur propose des choses un peu dignes. Dans cette période très sombre, reconnaître que l'avenir de la nation, c'est pas les vieux, même si ce sont eux qui votent ! Un pays qui ne prend pas soin de sa jeunesse, c'est mauvais signe. Avec un président jeune, c'est stupéfiant.
Dorothée Gilbert. J'attends des solutions pour pouvoir danser, chanter, jouer malgré les contraintes. De nouvelles idées, de nouvelles envies. Le public est là, lui. Il a montré qu'il n'avait pas peur.
ELLE. Que vous apporte l'art au quotidien ?
Benjamin Biolay. Moi, ça a sauvé ma vie ! Je ne me voyais pas faire autre chose. Mais quelqu'un qui voudrait commencer dans la musique aujourd'hui… si c'est dans une interview pour un magazine, je lui dirais : « Vas-y, qui ne tente rien n'a rien. » Mais si c'est mon petit neveu ou ma fille, qui est une adolescente, je lui dis : « Passe ton bac, d'abord ! » Je sais, c'est horrible.
Dorothée Gilbert. Ma fille a 6 ans et demi, donc ça va, elle a tout compris – on reste à la maison pour protéger les plus fragiles – et le vit bien. À cet âge, il y a encore peu d'interactions sociales.
Benjamin Biolay. Pour les ados, c'est dur, on les empêche de baiser !
(Isabelle Adjani, bouillonnante, prend la parole alors qu'on lui demande le mot de la fin.)
Isabelle Adjani. Les gens sont comme nous, ils se tiennent debout, à la verticale, en se disant : on tient, on tient. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'injonction de tenir le coup jusqu'à s'en rendre malade, car quid du « monde d'après » qui se prépare ? Ou plutôt, quid d'un « monde avec » ? Il y a de quoi se sentir manipulé(e).
ELLE. Manipulée ?
Isabelle Adjani. Ce fameux Conseil scientifique et ses suiveurs nous parlent de la science comme d'une religion. Il faut avoir la foi en leurs prêches.
ELLE. Et pour en revenir aux artistes ?
Isabelle Adjani. Le regard condescendant sur notre profession transparaît dans toutes les consignes. On nous redit : « Adaptez-vous », comme si ce n'était pas la nature même de notre travail de nous adapter !
Benjamin Biolay. Absolument, c'est insultant. Quand on nous dit : « Réinventez-vous », « Chevauchez le tigre »…, mais je fais ça tous les matins, moi, c'est mon travail.
Isabelle Adjani. Depuis le début, le côté « préparez-vous », « écrivez vos scénarios pour quand on déconfinera », c'est humiliant. Il y a eu, en mai, une interview somptueuse de Christophe Honoré dans « Le Monde », d'une vérité et d'une mélancolie absolues. Il y disait, en résumé : ne croyez pas que ça ne va pas laisser de traces, que ça va être sans séquelles, non, ce n'est pas du temps qu'on nous donne, c'est du temps qu'on nous prend. Mais, pour entendre ça, il faut être sensiblement curieux du rapport vertueux que les artistes ont avec leur travail et avec la notion de transmission qui fonde chez la plupart leur vocation, du moins cela vaut pour moi. Notre existence n'est pas accessoire, les artistes sécrètent des antidotes puissants, si on les castre, si on les uniformise, si on leur impose un programme dépersonnalisant la manière dont ils se produisent, on floute toute créativité… Autant nous effacer. Tout sauf se réinventer.
Benjamin Biolay. Le seul truc artistique, c'est le flou… en France !
Isabelle Adjani.On se conduit un peu aussi comme des gens coupables d'occuper une place à part dans la société, même si nous contribuons symbiotiquement à la faire vivre, comme le dit Benjamin. Les artistes sont inquiets, par les temps de jugement qui courent, d'être perçus comme indécents à faire valoir leur indignation de « cultureux pourris gâtés ». Vous trouvez ça normal qu'il y ait autant de subventions dans la culture en France, et ceci-cela…? Si vous la ramenez, gare à vous ! Oui, oui, on est coupables, pardon, pardon, excusez-nous, c'est pas juste, hein, on n'a pas le droit…
Benjamin Biolay. C'est vrai qu'on se fait renvoyer dans les cordes dès qu'on dit un truc. Dans l'imaginaire des gens, quand t'es un artiste, soit t'es blindé, soit t'es taré.
Isabelle Adjani. Pour ma part, je me vois mal continuer à vivre ça de cette façon.
Dorothée Gilbert. Pour moi, le plus dur, c'est de ne pas pouvoir du tout se projeter, de vivre au jour le jour, je déteste ça, mais c'est une question de tempérament.
Benjamin Biolay. J'ai très peur pour la créativité, je n'ai pas un ami, et je m'inclus dans le lot, qui a écrit une bonne chanson depuis neuf mois.
Isabelle Adjani. Embarrassant d'être traités comme des scolaires dissipés, non ? « Vous n'avez pas besoin de conditions idéales pour ramener de bonnes notes… »
Benjamin Biolay. Toute la société est traitée ainsi, alors imagine, nous, les « gogols » d'artistes !